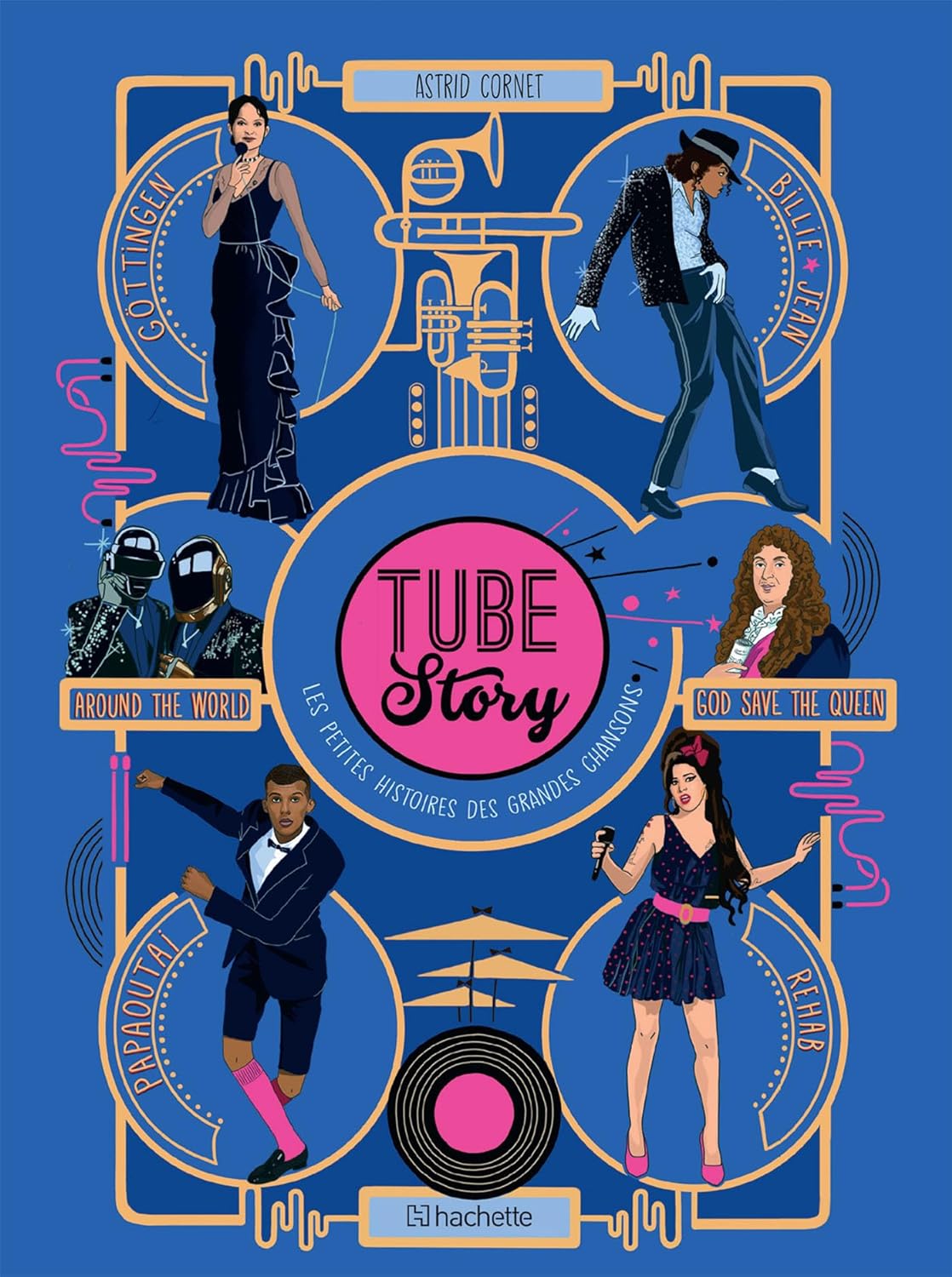Le 7/02/2024, au théâtre des Béliers, un homme s’est présenté à nous. Cet homme s’appelle Asher Lev. Un nom à la Jean Durand, un nom qui se confond dans la communauté juive hassidique du New-York d’après-guerre. Cette personne est fictive, elle sort tout droit de l’imagination de Chaïm Potok, romancier, peintre et rabbin qui a vécu à l’époque contemporaine de son histoire.
En s’inspirant de sa vie, il transforme néanmoins Asher en figure d’identification pour tous juifs de son époque mais pas seulement, car l’histoire d’Asher résonne douloureusement, ou avec consolation, chez tous les êtres qui cherchent à s’émanciper pour respecter et faire venir au monde l’essence même de leurs âmes.
Je m’appelle Asher Lev : Pourquoi la scène ?
C’est un sujet qui a profondément touché Hannah-Jazz Mertens en lisant l’adaptation théâtrale américaine d’Aaron Posner. C’est effectivement un sujet poignant. Depuis sa petite enfance, depuis qu’il a 6 ans, Asher sent que le don du dessein l’habite. Il ne peut s’empêcher de tracer des lignes, des courbes, de dessiner ses parents qui seront ses premiers modèles. Mais quand sa folie le prend à représenter le Rebbe sur les pages sacrées du Talmud, son père s’indigne. La colère, née de l’incompréhension entre le père et le fils, embrase la demeure familiale, pourtant rempli d’amour, et écartèle la mère. Heureusement ou malheureusement pour lui, le Rebbe, Jacob Kahn, et son oncle deviendront comme des météorites qui bouleverseront son univers en ouvrant une perspective sur un autre monde : le monde de l’Art.
Commence alors, petit à petit, la métamorphose d’Asher, tout en douceur, et toujours fidèle à son éducation. Mais même si la part des fondements de sa personnalité reste intacte, son autre lui, son don-démon qui l’habite, le pousse à réaliser son œuvre et à parler un langage que son père ne comprend pas. En réalité, c’est assister véritablement au déchirement interne d’une cellule familiale qui rend intelligemment sensible l’adaptation théâtrale. Même si ces deux mondes pouvaient sembler étrangers au public présent dans la salle, la passion artistique ou la communauté juive hassidique, la thématique du Moi et des autres nous rassemblait. Cette œuvre sur scène déclenche la cathartique de la pitié. Quelle peine devant Asher qui essaie de naître au monde et quelle meurtrissure face aux yeux humides des parents lorsqu’ils découvrent leur humiliation.
Le jeu des acteurs :
S’il y a bien quelque chose qui fascinera toujours, c’est comment un homme peut en devenir trois autres en l’espace de quelques secondes. Guillaume Bouchède, bravo pour cette prouesse magistrale d’incarner ces quatre figures paternelles : le Rebbe, le père, Jacob et l’oncle. Un acteur pour ces trois figures crée à la fois cette cohérence autour des influences paternelles et une contiguïté dans leur travail respectif auprès d’Asher. Vraiment, il nous semblerait voir deux acteurs différents entre Jacob Khan et le père tant les personnalités sont différentes mais nous ne voyons là que la dextérité d’un acteur professionnel.
Stéphanie Caillol, merci pour les larmes provoquées par votre cri de douleur et votre égarement dans le rôle de cette femme-mère-sœur. Entourée d’hommes, elle est le doux mais invincible lien qui les relie. Des doux mots de protection prononcés en Yiddish résonnent encore en nous. Cette femme, qui a perdu toute sa famille, doit honorer la mémoire de son frère, son héritage personnel mais elle doit être forte pour sa famille dont les fondations commencent à être poreuses. Enfin Martin Karmann, quel charme ! joué l’enfant et le jeune adulte, le génie et l’ingénu. Merci pour ces regards plein de sincérité, de fragilité et d’humour et pour ces mots prononcés tout comme un cœur déchiré doit les prononcer.
C’est par ce mélange subtil entre poésie, humour et trivialité de la vie familiale que Mertens nous fait vibrer. C’est une réussite, en témoigne le public qui vous acclamait debout. Je pense que voir, non regarder, cette histoire en chair et en os a fait du bien à beaucoup de monde. Tout comme ce commandement gravé sur le mur de la synagogue au sortir du théâtre : « tu dois aimer ton prochain comme toi-même » si c’est un merveilleux hasard , il nous aide à poursuivre notre réflexion sur ce qu’implique réellement ces mots.
Conclusion de notre critique sur « Je m’appelle Asher Lev « :
Le monde juif a donné naissance à un artiste, à la fois divin et satanique, avec le pouvoir de guérir et de blesser, or blesser son propre père ce n’est pas respecter son père et ce n’est pas respecter le commandement divin. Cette pièce incarne ce sujet inlassable de la limite de la liberté d’expression et d’être au milieu d’êtres semblables.
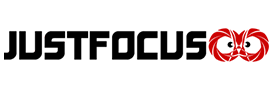














![[Live Report] Rock En Seine 2024 : 20 ans et toujours aussi passionnés !](https://www.justfocus.fr/wp-content/uploads/2024/11/RES24_JOUR01_LANA-DEL-REY_LOUIS-COMAR-12.jpg)