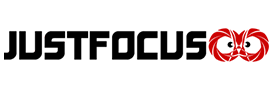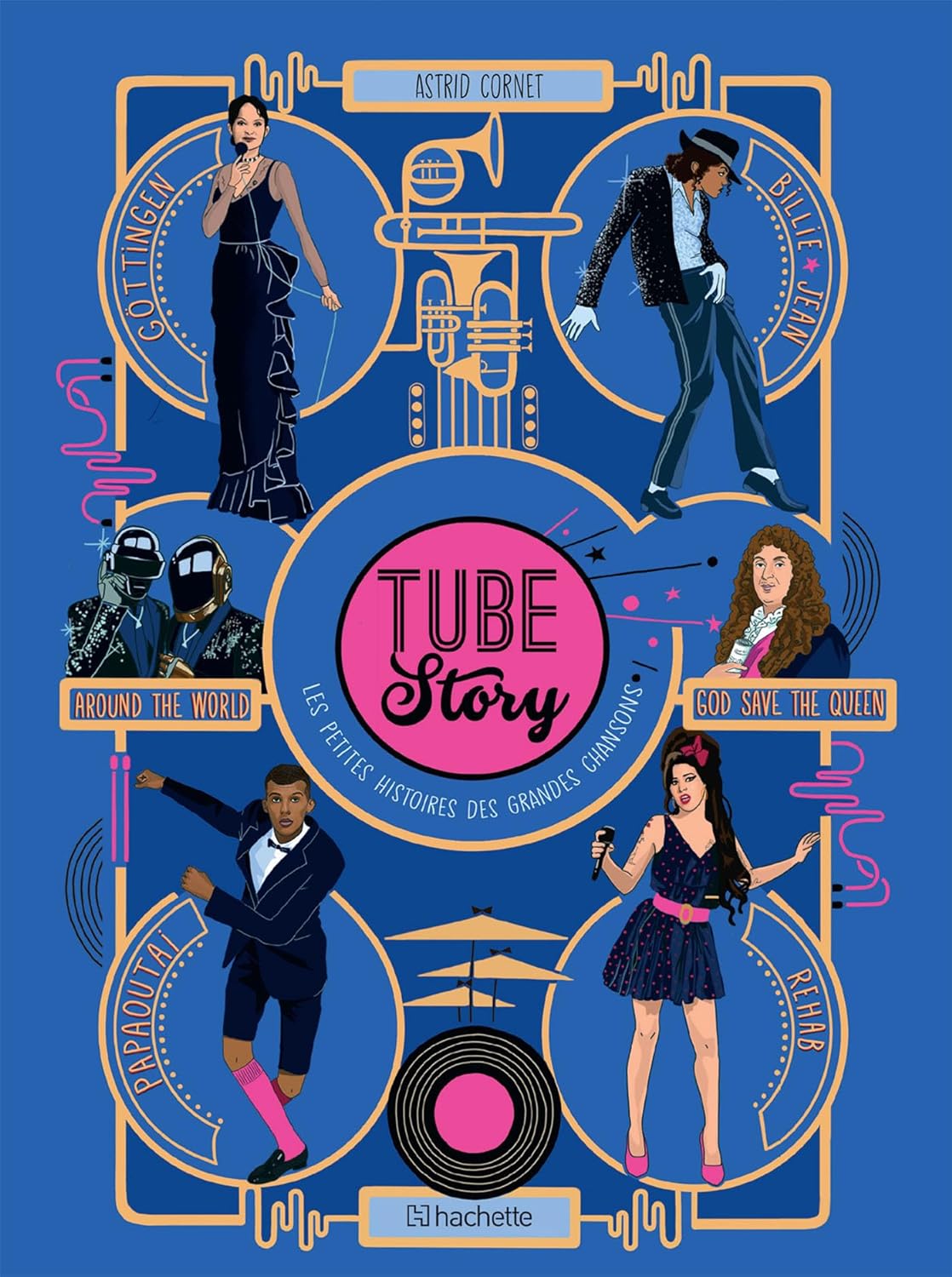Réparer les Vivants suit en vingt-quatre heures le parcours du cœur de Simon, jeune homme de 19 ans, en état de mort cérébrale, transplanté dans le corps de Claire, femme de 51 ans, atteinte de myocardite.
Le roman, publié par Maylis de Kerangal en 2014, est un best-seller. Vendu à des centaines de milliers d’exemplaires, il est adulé par la critique, récompensé par une dizaine de prix littéraires, adapté deux fois au théâtre (par Emmanuel Noblet puis par Sylvain Maurice) et une fois au cinéma (par Katell Quillévéré). Cet intérêt notable peut s’expliquer par la polémique qui agite l’hexagone à cette période : une proposition de loi, rendant le don d’organes « automatique », qui viendrait compléter celle du « consentement présumé » appliquée – théoriquement – depuis 1976. Théoriquement, car dans les faits, le nombre d’oppositions s’élève toujours à 30% et le nombre d’inscrits au registre national des refus a considérablement augmenté depuis 2014. Dans un texte précis et très documenté sur le plan médical, l’autrice invite le lecteur à réfléchir sur le sujet, en le plongeant dans un récit haletant et parsemé de personnages hauts en couleur.
Cette version scénique, créée en 2015, est signée par Sylvain Maurice, metteur en scène et directeur du Centre Dramatique National de Sartrouville – un de ces lieux de la périphérie parisienne qui se veut l’emblème de la « démocratisation culturelle ». Avec, à ce jour, une trentaine de mises en scène, il interroge dans ses créations le rapport entre les disciplines artistiques. Cette année, il crée Ma Cuisine, un spectacle associant théâtre d’objets, vidéo, musique et recettes de cuisine. Il s’entoure, pour Réparer les Vivants, du comédien Vincent Dissez (artiste associé au Théâtre National de Strasbourg), avec lequel il avait déjà travaillé en 2009 sur Richard III de Shakespeare ; et du musicien et compositeur Joachim Latarjet (par ailleurs metteur en scène et fondateur de la compagnie Oh ! Oui).

Le récit est, avant tout, celui d’une course contre la montre, d’un compte à rebours de vingt-quatre heures au cours desquelles chaque seconde recèle un enjeu vital : Maylis de Kerangal adopte un style rythmé par des phrases longues, des juxtapositions et des énumérations. Pour rendre compte de l’urgence et de la rapidité de cette narration, Sylvain Maurice procède à de nombreuses coupes. Il choisit de mettre en évidence la chronologie, la linéarité de l’histoire, et passe sous silence les retours en arrière ou les digressions de l’autrice. Le travail est axé sur le rythme, celui de la parole – tantôt effrénée, tantôt posée – mais aussi celui de la musique, omniprésente. Les thèmes principaux qui composent la dramaturgie de l’œuvre (la vie, la mort, le deuil), sont conservés, voire accentués par cette transposition scénique : le plateau rend notamment possibles les unités de temps et d’action qui ponctuent la fable.
Il permet de souligner des thématiques récurrentes du roman, comme celle de la « belle mort » : une notion héritée des Grecs voulant qu’une mort héroïque (au combat, dans la fleur de l’âge) soit plus « belle » qu’une mort lente, de vieillesse ou de maladie. Cet « ars moriendi » (art de bien mourir) se retrouve entre autres dans l’importance donnée à la restauration du corps, que la famille a peur de retrouver « déchiqueté » après les prélèvements d’organes. L’autre thématique essentielle est celle de la « réparation » dont il est question. Le titre est une citation tirée de Platonov d’Anton Tchekhov, lorsque Voïnitzev demande à Triletzski : « Qu’allons nous faire, Nicolaï ? » et que celui-ci répond « Enterrer les morts et réparer les vivants ». Cette notion de « réparation », qui évoque la mécanique et le matériel inanimé plus que les humains, renvoie à une dimension assurément éthique : qu’est-il juste, qu’est-il autorisé de faire pour permettre au vivant de continuer à exister ? Est-ce une question de « générosité » que de faire don de ses organes, comme le demande l’infirmier-coordonnateur aux parents du défunt ? Est-ce un choix individuel ou, au contraire, un choix collectif (familial, sociétal) ?
Ces interrogations, Sylvain Maurice leur donne corps à travers un acteur, seul, venu raconter l’histoire à la manière d’un aède : cet artiste qui, en Grèce antique, chantait des épopées accompagné d’un instrument de musique. Il ne s’agit plus ici d’incarner les personnages mais de les suggérer, de les évoquer par de minutieux détails de posture et de diction. Tous deviennent ainsi les maillons d’une même chaîne, d’une même course dont Vincent Dissez se fait le narrateur polyphonique. Aux unités d’action et de temps s’ajoute aussi celle de lieu, puisque le spectacle se déroule sur un espace unique : un tapis roulant, entouré d’un dispositif portant en forme d’arche. Au sein de cette machine monumentale, le comédien évolue au sol, en déséquilibre sur le tapis roulant, tandis que le musicien est placé au-dessus, qu’il surplombe la scène. Cette scénographie (conçue par Eric Soyer, collaborateur habituel de Joël Pommerat), symbolique plus que réaliste, permet une multiplicité d’interprétations : nous pouvons y voir un mausolée, ou un arc de triomphe en hommage à « l’héroïsme » de Simon, ou encore une matérialisation de l’urgence par le tapis de course, voire même une porte vers un au-delà. La verticalité confère au spectacle une dimension transcendante, accentuée par la lumière blanche et froide qui éblouit le spectateur. Sur scène, comédien comme musicien sont toujours présents, les pauses sont peu nombreuses. Le spectacle est aussi technique que ne l’est le texte. Puisque Vincent Dissez et Joachim Latarjet ne se voient pas, ils ne peuvent travailler que dans l’écoute l’un de l’autre. Ils jouent ensemble, à l’aveugle. La musique n’a pas seulement un rôle d’illustration, elle constitue un récit parallèle, elle raconte sa propre histoire avec son propre langage et participe, à sa manière, à la tension et à la nervosité du spectacle.
C’est, en somme, une prestation qui réunit trois virtuoses : Sylvain Maurice à la mise en scène, Vincent Dissez à l’interprétation et Joachim Latarjet à la musique. Virtuoses, car il faut exceller dans son art pour réussir cette performance digne d’un trio d’équilibristes, d’une justesse et d’une précision à couper le souffle.
Sans rien enlever à la qualité du spectacle, il est toutefois possible de s’interroger sur le succès de cette œuvre. Que nous dit cette « course aux adaptations » de la société dans laquelle nous vivons ? Est-ce vraiment faire du théâtre « démocratisé » que de proposer deux spectacles, abordant le même texte, l’un dans la sphère du théâtre subventionné, l’autre oscillant entre le Off d’Avignon et les scènes nationales des territoires ? Cette triple adaptation ne nous raconterait-elle pas plutôt, en filigrane, l’uniformisation des thématiques (et avec elle, celle des manières de penser) que connaissent l’art et le spectacle vivant ? Si l’enveloppe des subventions est resserrée pour les jeunes artistes, elle semble suffisamment abondante pour financer à travers les mêmes canaux deux adaptations d’un même roman, à un an d’intervalle. Dans l’une de ses notes d’intention, Sylvain Maurice écrit que « [le texte de] Maylis de Kerangal décrit ce que pourrait être l’Humanité : des gens qui s’entraident pour vivre. » Mais de quelle Humanité parle-t-on ? De l’espèce entière, ou seulement des élites ? À chacun d’en juger.
Le spectacle, lui, est à découvrir en tournée le 6 novembre au Théâtre de l’Agora (scène nationale d’Évry et de l’Essonne), puis du 21 novembre au 1er décembre au Théâtre National de Strasbourg et finalement le 5 décembre à l’Agora (Boulazac).