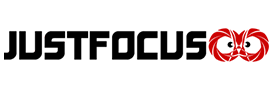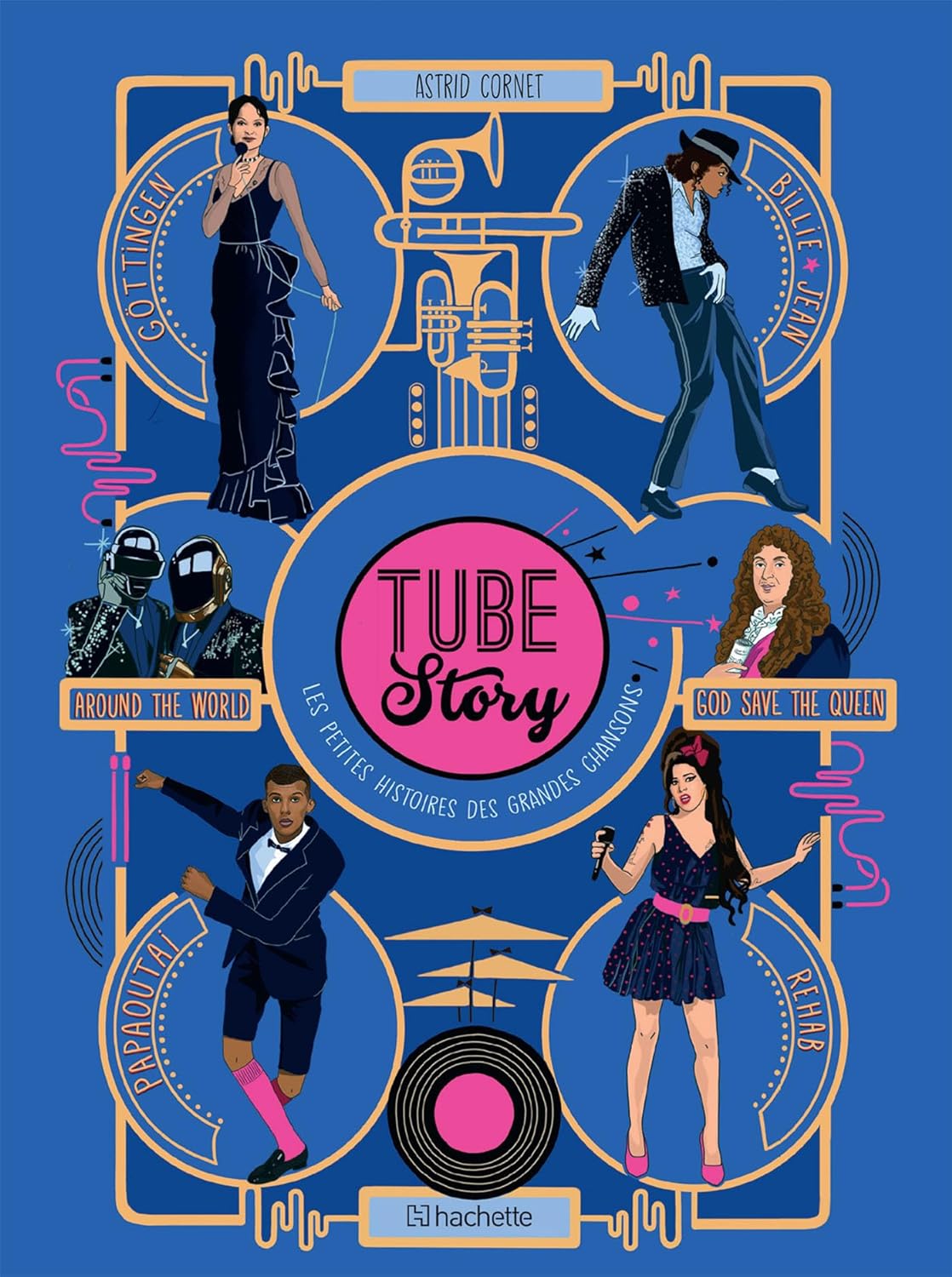Le Quatrième Mur raconte l’histoire d’une française qui promet à son ami mourant de poursuivre le travail qu’il avait initié : monter Antigone à Beyrouth (Liban) avec des comédiens de toutes les confessions, en pleine guerre civile.
La guerre du Liban démarre au cours des années 70 et est liée, d’une part, à la cohabitation imposée par la France de plusieurs communautés sur le même territoire (dans le but de les affaiblir) et, d’autre part, à l’ingérence des pays voisins dans la politique interne. À partir de 1926, le pays est partagé entre les maronites (chrétiens), les chiites (musulmans), les sunnites (musulmans) et les druzes (musulmans également), auxquels viennent s’ajouter les réfugiés palestiniens (musulmans) ayant fui leur pays après la naissance de l’État d’Israël (1948). La corruption des dirigeants et le communautarisme marqué entraînent un accroissement des inégalités et une augmentation du chômage des libanais (10% de la population active en 1970) au profit des palestiniens, qui constituent une main d’œuvre abondante, bon marché et peu exigeante. De plus, la résistance palestinienne (OLP) – s’organisant depuis le Liban avec l’accord du gouvernement (Accord du Caire, 1969) – fait s’accroître les tensions entre les pouvoirs israélien (juif, allié des maronites) et libanais (sunnite, allié des palestiniens). En 1975, le conflit armé éclate et Beyrouth est scindée en deux par une ligne de démarcation (la ligne verte) opposant les phalangistes chrétiens aux palestiniens musulmans.
L’action se déroule ici en 1982, sept ans après le début des hostilités et juste avant l’opération « Paix en Galilée » (invasion du Liban par Israël et occupation de Beyrouth). La metteuse en scène doit rassembler des acteurs issus des différentes factions politiques et religieuses pour jouer la pièce de Jean Anouilh (écrite sous l’Occupation) : Antigone sera palestinienne et sunnite, Hémon, un druze du Chouf, Créon (roi de Thèbes et père d’Hémon), un maronite de Gemmayzé et le reste de la distribution sera complété par des chiites. L’entreprise a quelque chose d’utopiste, voire de suicidaire, et pourtant de terriblement excitant.

Le texte est un roman de Sorj Chalandon, écrivain, journaliste (à Libération pendant trente-quatre ans puis au Canard Enchaîné depuis 2009), à qui l’on doit la couverture médiatique du procès de Klaus Barbie (criminel de guerre nazi) en 1987. Récompensé par le prix Goncourt des lycéens en 2013, Le Quatrième Mur a déjà fait l’objet d’une adaptation en bande dessinée et de huit adaptations au théâtre depuis 2016. Julien Bouffier, qui signe cette version, dirige la compagnie Adesso e sempre depuis 1991. Avec une vingtaine de créations à son actif, il entend « travailler les questions sociétales sur scène ». C’est la deuxième fois qu’il évoque le mythe d’Antigone, après la création d’Andy’s Gone en 2016, qui traitait du désir de désobéissance d’une adolescente face à la proclamation de l’état d’urgence.
Le décor est simple, composé d’une sorte d’escalier (ou de passerelle) sur lequel se déroule la majorité de l’action. Si la musique possède une importance capitale – elle contribue pour beaucoup à créer l’univers esthétique du metteur en scène – c’est la vidéo qui occupe vraiment une place prépondérante dans son travail. Plus qu’un outil, elle est une véritable frontière entre deux mondes : entre Paris et Beyrouth, entre la fiction et la réalité, entre les spectateurs et les acteurs. Cet écran (ce quatrième mur) enferme les comédiennes dans le dispositif scénique, les transposant par-là même dans une dimension intermédiaire entre le plateau et la vidéo.
Le spectacle aime jouer avec les frontières, à commencer par celles du réel, dans un esthétisme proche du documentaire : en 2016, l’équipe du spectacle est partie à Beyrouth (à la rencontre d’acteurs locaux ?) et la comédienne qui interprète Yara sur scène garde son nom. Le lieu choisi pour la représentation d’Antigone est un ancien cinéma sur la ligne de démarcation et les acteurs semblent confondre leur rôle avec la vie réelle : ils n’acceptent pas de jouer pour l’acte de résistance que cela représente mais pour « le plaisir de condamner à mort une palestinienne ». D’une certaine façon, le théâtre reprend ici sa fonction cathartique : ils jouent pour se purger de leurs fantasmes. Mais cette proximité avec le réel est aussi étrangement l’occasion d’une distanciation par rapport à celui-ci. Le texte est fort, parfois violent et les pires images ne sont pas celles que l’on voit, ce sont celles que l’on entend. Alors, l’écran nous ramène à notre condition de spectateurs : ce n’est que du théâtre et ce théâtre doit nous inciter à réfléchir.
L’interrogation sous-jacente, c’est celle de la place de la création, du rôle de l’art face aux atrocités et à la barbarie. C’est aussi, sans doute, un spectacle sur la laïcité, sur le vivre ensemble au-delà des confessions religieuses, sur la possibilité d’une citoyenneté commune au-delà des individualités. Le théâtre peut-il assumer cette portée civique ? Et par quels moyens ? Faire du théâtre, c’est mettre en commun nos cultures personnelles pour faire culture ensemble. La fraternisation est bien plus dangereuse pour les gouvernements (responsables des guerres) que la prise des armes. La fraternisation est le début de la contestation, de la désobéissance, car c’est ce qui permet de reconnaître autrui comme son égal et annihiler de ce fait la propagande de guerre qui diabolise l’ennemi.
Est à saluer également le jeu des acteurs (sur scène comme en vidéo) qui servent avec brio le texte de Sorj Chalandon : Yara Bou Nassar, Alex Jacob, Vanessa Liautey, Nina Bouffier, Joyce Abou Jaoude, Diamand Bou Abboud, Mhamad Hjeij, Raymond Hosni, Elie Youssef et Joseph Zeitouny.
Le spectacle est à découvrir jusqu’au 26 mai 2018 au Théâtre Paris-Villette.