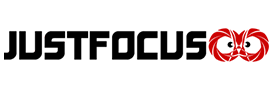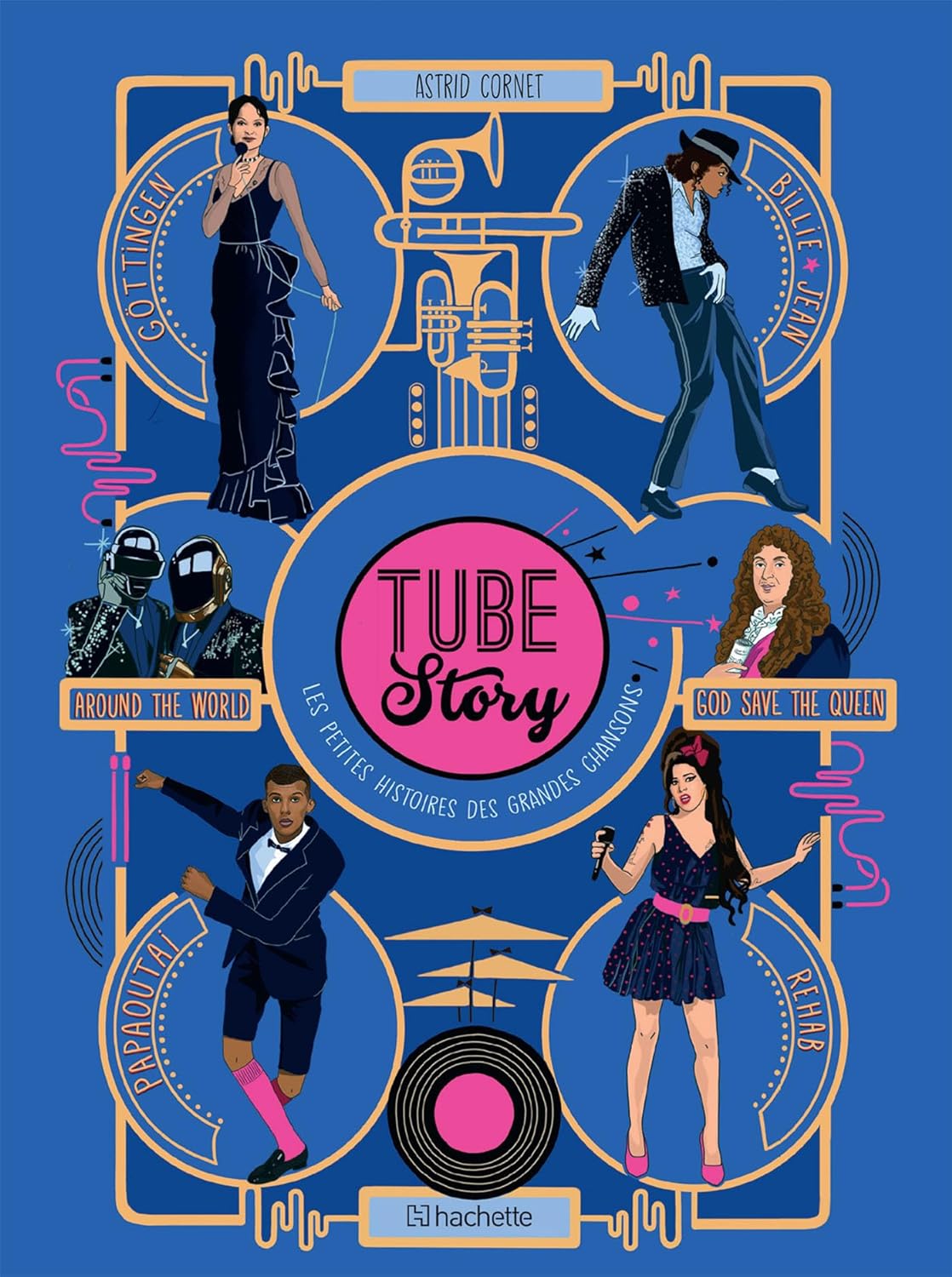La Philharmonie de Paris, ex Cité de la Musique, a maintenant l’habitude d’accueillir en son sein les rétrospectives d’artistes ayant compté pour la musique d’hier et d’aujourd’hui. John Lennon, David Bowie, mais aussi des artistes satellites de la musique comme les peintres Chagall et Paul Klee, du joli monde musical mis en perpective sous la forme d’une exposition. Cette fois, il s’agit du groupe mythique fondé par feu Lou Reed, le Velvet underground, ayant existé entre 1965 et 1970.
 Fondé en 1965 par Lou Reed (guitare, chant et principales compositions), John Cale (Violon, alto, piano, basse, chant), Sterling Morrison (2ème guitare) et Maureen Tucker (batterie) à New York, le ciment du Velvet Underground restera le duo Reed / Cale. L’exposition démarre ainsi en soulignant l’apparente absence de points communs entre les deux musiciens : le 1 er issu de la bourgeoisie juive se rebelle bien assez tôt contre le conformisme dominant et l’étroitesse d’esprit, quand le 2 ème, un protestant gallois issu de la classe populaire, suit des études musicales académiques qui l’orientent a priori vers une carrière de chef d’orchestre. Mais rapidement, lorsque les deux hommes se rencontrent à New York, ils partagent cette même passion de repousser les limites de la musique (et les leurs également, via les drogues). C’est ainsi que le fruit de leurs visions donnent naissance au Velvet, et c’est au Café Bizarre qu’ils se produisent d’abord, le refuge du beatnik typique de l’époque. Faisant fi des conventions, marginaux et sans tabou, les habitués du lieu vont apprécier alors ces musiciens qui se réapproprient le rock’n roll encore jeune pour le travestir en outil d’expression musicale déconstruite, aux harmonies audacieusement repensées pour une expérience auditive nouvelle. Une tension musicale, à la bestialité latente, va alors rendre les badauds du bar accros à cet univers, parmi lesquels l’associé du chantre de l’art contemporain, Andy Warhol. Ce dernier ne tarde pas à les inviter dans son atelier, la Factory, où il les met en scène dans des performances mêlant leur musique, des vidéos expérimentales et des performances de body art et sado-masochistes. Ils portent alors des lunettes noires et exécutent leur répertoire dans ce même registre torturé.
Fondé en 1965 par Lou Reed (guitare, chant et principales compositions), John Cale (Violon, alto, piano, basse, chant), Sterling Morrison (2ème guitare) et Maureen Tucker (batterie) à New York, le ciment du Velvet Underground restera le duo Reed / Cale. L’exposition démarre ainsi en soulignant l’apparente absence de points communs entre les deux musiciens : le 1 er issu de la bourgeoisie juive se rebelle bien assez tôt contre le conformisme dominant et l’étroitesse d’esprit, quand le 2 ème, un protestant gallois issu de la classe populaire, suit des études musicales académiques qui l’orientent a priori vers une carrière de chef d’orchestre. Mais rapidement, lorsque les deux hommes se rencontrent à New York, ils partagent cette même passion de repousser les limites de la musique (et les leurs également, via les drogues). C’est ainsi que le fruit de leurs visions donnent naissance au Velvet, et c’est au Café Bizarre qu’ils se produisent d’abord, le refuge du beatnik typique de l’époque. Faisant fi des conventions, marginaux et sans tabou, les habitués du lieu vont apprécier alors ces musiciens qui se réapproprient le rock’n roll encore jeune pour le travestir en outil d’expression musicale déconstruite, aux harmonies audacieusement repensées pour une expérience auditive nouvelle. Une tension musicale, à la bestialité latente, va alors rendre les badauds du bar accros à cet univers, parmi lesquels l’associé du chantre de l’art contemporain, Andy Warhol. Ce dernier ne tarde pas à les inviter dans son atelier, la Factory, où il les met en scène dans des performances mêlant leur musique, des vidéos expérimentales et des performances de body art et sado-masochistes. Ils portent alors des lunettes noires et exécutent leur répertoire dans ce même registre torturé.
Du Café Bizarre à Nico
 Croyant à leur potentiel, Warhol pense alors à attirer plus de fans du Velvet en introduisant au groupe la jeune mannequin allemande Nico, une jolie et grande blonde qui va alors officier comme chanteuse sur quelques morceaux. D’autres, composés et chantés par Reed et Cale, vont suivre, adopter un chemin plus accessible, et prendre une envergure nouvelle pour constituer le son Velvet. Fin prêt, le premier album du groupe « The Velvet Underground And Nico » sort en 1967. Bien accueilli, l’album sortira rapidement du circuit, à cause d’un différend commercial avec un des associés de Warhol, et tombera ainsi dans l’oubli, jusqu’au début des années 70. Qu’à cela ne tienne : les 11 morceaux sont aujourd’hui considérés comme des classiques absolus. D’abord parce qu’ils constituent une expérience musicale inouïe, une année avant que les Beatles et les Stones n’entament leur mue exploratrice et initiatique de 1968 : finis les rythmes binaires, les schémas couplets / refrains normés depuis Elvis, les thématiques fédératrices insouciantes de la jeunesse dorée du baby boom. Désormais, on chante son impatience à voir arriver son dealer dans « Waiting for my man », par dessus une guitare rhythmique étouffé, un piano dissonant et un chant négligé. C’est plus la même ambiance que le « Sunny Afternoon » des Kinks… La référence la plus appuyée des drogues sera « Heroin », un brulot expiatoire qui à l’aide
Croyant à leur potentiel, Warhol pense alors à attirer plus de fans du Velvet en introduisant au groupe la jeune mannequin allemande Nico, une jolie et grande blonde qui va alors officier comme chanteuse sur quelques morceaux. D’autres, composés et chantés par Reed et Cale, vont suivre, adopter un chemin plus accessible, et prendre une envergure nouvelle pour constituer le son Velvet. Fin prêt, le premier album du groupe « The Velvet Underground And Nico » sort en 1967. Bien accueilli, l’album sortira rapidement du circuit, à cause d’un différend commercial avec un des associés de Warhol, et tombera ainsi dans l’oubli, jusqu’au début des années 70. Qu’à cela ne tienne : les 11 morceaux sont aujourd’hui considérés comme des classiques absolus. D’abord parce qu’ils constituent une expérience musicale inouïe, une année avant que les Beatles et les Stones n’entament leur mue exploratrice et initiatique de 1968 : finis les rythmes binaires, les schémas couplets / refrains normés depuis Elvis, les thématiques fédératrices insouciantes de la jeunesse dorée du baby boom. Désormais, on chante son impatience à voir arriver son dealer dans « Waiting for my man », par dessus une guitare rhythmique étouffé, un piano dissonant et un chant négligé. C’est plus la même ambiance que le « Sunny Afternoon » des Kinks… La référence la plus appuyée des drogues sera « Heroin », un brulot expiatoire qui à l’aide  d’un violon hurlant devenu hors de contrôle sera le cri le plus désespéré que Lou Reed ait pu faire dans sa carrière. La gueule de bois et son spleen a sa plus belle et désarmante illustration dans la sublime ballade « Sunday Morning » (« Ce sont ces années gâchées tellement proches derrière »). Quant à Nico, elle sera cette présence féminine dans la musique du Velvet, que Lou Reed n’a pas vraiment voulu, mais qu’on retiendra comme une altérité sonore assez fascinante. De part sa voix sensuelle et fantomatique qui fait de « All tomorrow’s parties » une vraie bacchanale enivrante, ouvrant les portes imaginaires du plaisir obscur. Ou bien « I’ll Be Your Mirror » un touchant acte musical, désarmant de sobriété et de nudité sonore.
d’un violon hurlant devenu hors de contrôle sera le cri le plus désespéré que Lou Reed ait pu faire dans sa carrière. La gueule de bois et son spleen a sa plus belle et désarmante illustration dans la sublime ballade « Sunday Morning » (« Ce sont ces années gâchées tellement proches derrière »). Quant à Nico, elle sera cette présence féminine dans la musique du Velvet, que Lou Reed n’a pas vraiment voulu, mais qu’on retiendra comme une altérité sonore assez fascinante. De part sa voix sensuelle et fantomatique qui fait de « All tomorrow’s parties » une vraie bacchanale enivrante, ouvrant les portes imaginaires du plaisir obscur. Ou bien « I’ll Be Your Mirror » un touchant acte musical, désarmant de sobriété et de nudité sonore.Terres inconnues et esthètes du rock
 « White Light White Heat » qui sortira juste après sera le plus fidèle aux intentions premières du groupe, avant que Nico les médiatise : le son crade, distordu et atonale cher aux expériences de Reed et de Cale va reprendre possession du son Velvet. Bien qu’à l’attirance compliquée pour des oreilles non initiées, cet album est majeur dans le rock qui vient à peine d’arriver à maturité. Une décennie avant le punk, une génération au moins avant que le post-punk, le grunge, le rock alternatif et le post-rock ne soient les nouveaux sous-genre d’un style qu’on a annoncé mort plus d’une fois, « White Light White Heat » les devance déjà. Le titre éponyme en sera une vitrine efficace, pour celui qui tente de s’aventurer dans la suite. 1968 est là, le Flower Power et la libération sexuelle battent leur plein, et les Velvet en jouent : dans « The Gift » les diverses expériences sexuelles et psychédéliques sont racontées sous un fond instrumental fait de larsen, de saturations extrêmes. On aurait dit les solo de Jimi Hendrix samplés et cadensés nerveusement par le jeu de guitare. « I heard Her Call My Name » quant à lui se propose ni plus ni moins de préfigurer la carrière de Sonic Youth, tant les ingrédients du mythique groupe de noise des années 80 sont déjà présents (on y entendrait presque « Hot Wire My Heart »). Dans « Sister Ray », morceau fleuve sans pilote, aux orgues poussés jusqu’à leurs retranchements, et qui clôt l’album, ce sont peut-être les 17 minutes les plus libres que le rock a pu produire.
« White Light White Heat » qui sortira juste après sera le plus fidèle aux intentions premières du groupe, avant que Nico les médiatise : le son crade, distordu et atonale cher aux expériences de Reed et de Cale va reprendre possession du son Velvet. Bien qu’à l’attirance compliquée pour des oreilles non initiées, cet album est majeur dans le rock qui vient à peine d’arriver à maturité. Une décennie avant le punk, une génération au moins avant que le post-punk, le grunge, le rock alternatif et le post-rock ne soient les nouveaux sous-genre d’un style qu’on a annoncé mort plus d’une fois, « White Light White Heat » les devance déjà. Le titre éponyme en sera une vitrine efficace, pour celui qui tente de s’aventurer dans la suite. 1968 est là, le Flower Power et la libération sexuelle battent leur plein, et les Velvet en jouent : dans « The Gift » les diverses expériences sexuelles et psychédéliques sont racontées sous un fond instrumental fait de larsen, de saturations extrêmes. On aurait dit les solo de Jimi Hendrix samplés et cadensés nerveusement par le jeu de guitare. « I heard Her Call My Name » quant à lui se propose ni plus ni moins de préfigurer la carrière de Sonic Youth, tant les ingrédients du mythique groupe de noise des années 80 sont déjà présents (on y entendrait presque « Hot Wire My Heart »). Dans « Sister Ray », morceau fleuve sans pilote, aux orgues poussés jusqu’à leurs retranchements, et qui clôt l’album, ce sont peut-être les 17 minutes les plus libres que le rock a pu produire.Et l’expo dans tout ça ?

A tant vouloir s’attacher aux sons, on oublierait presque les autres médias qui gravitent autour du groupe et du contexte. L’époque folle que les Etats-Unis vivent à ce moment là, à savoir l’immense vague libertarienne qui traverse la jeunesse, faite de transgression, de remise en cause de l’ordre établi et d’explosion des barrières conventionnelles. Que ce soit les moeurs sexuelles ou les formats des musiques, des films, de la peinture ou de la mode : chaque beatnik ou créateur y va de ses propres aventures. L’exposition installée à la Philharmonie se charge de montrer différents visuels, magazines, photographies, bandes dessinées, vidéos et photos du New York marginal, qui illustrent le contexte. On y voit aussi des installations sonores, photographiques et filmiques de chaque époque, via des extraits plus au moins expérimentaux, ou des courts métrages de nos contemporains actuels (Jonathan Caouette par exemple). Le tout respire une ambiance créatrice tous azimut et démontre une  recherche jusqu’au boutiste du plaisir, au détriment de la morale traditionnelle. La période la plus retentissante du groupe, lorsqu’ils se produisent à la Factory, est largement abordée, que ce soit l’imagerie autour de la fameuse « pochette à la banane » ou ce chapiteau sous lequel sont projetés des clips d’époque et des interviews, et que le public est invité à regarder allongé sur un matelas. Pas aussi prolifique que l’exposition précédente « David Bowie Is », « New York Extravaganza » aura quand même le mérite de fournir aux visiteurs une expérience immersive satisfaisante, notamment avec un casque permettant d’écouter toute la discographie du groupe, incluant leurs tout débuts avec des versions dénudées de « Heroin » ou « Waiting For My Man ».
recherche jusqu’au boutiste du plaisir, au détriment de la morale traditionnelle. La période la plus retentissante du groupe, lorsqu’ils se produisent à la Factory, est largement abordée, que ce soit l’imagerie autour de la fameuse « pochette à la banane » ou ce chapiteau sous lequel sont projetés des clips d’époque et des interviews, et que le public est invité à regarder allongé sur un matelas. Pas aussi prolifique que l’exposition précédente « David Bowie Is », « New York Extravaganza » aura quand même le mérite de fournir aux visiteurs une expérience immersive satisfaisante, notamment avec un casque permettant d’écouter toute la discographie du groupe, incluant leurs tout débuts avec des versions dénudées de « Heroin » ou « Waiting For My Man ».
Le Velvet était à l’honneur dans plusieurs concerts à la Philharmonie, dont celui de John Cale qu’on vous raconte ici.
The Velvet Undeground, New York Extravaganza, jusqu’au 21 août 2016 à la Philharmonie de Paris.