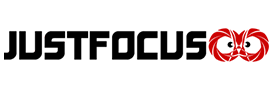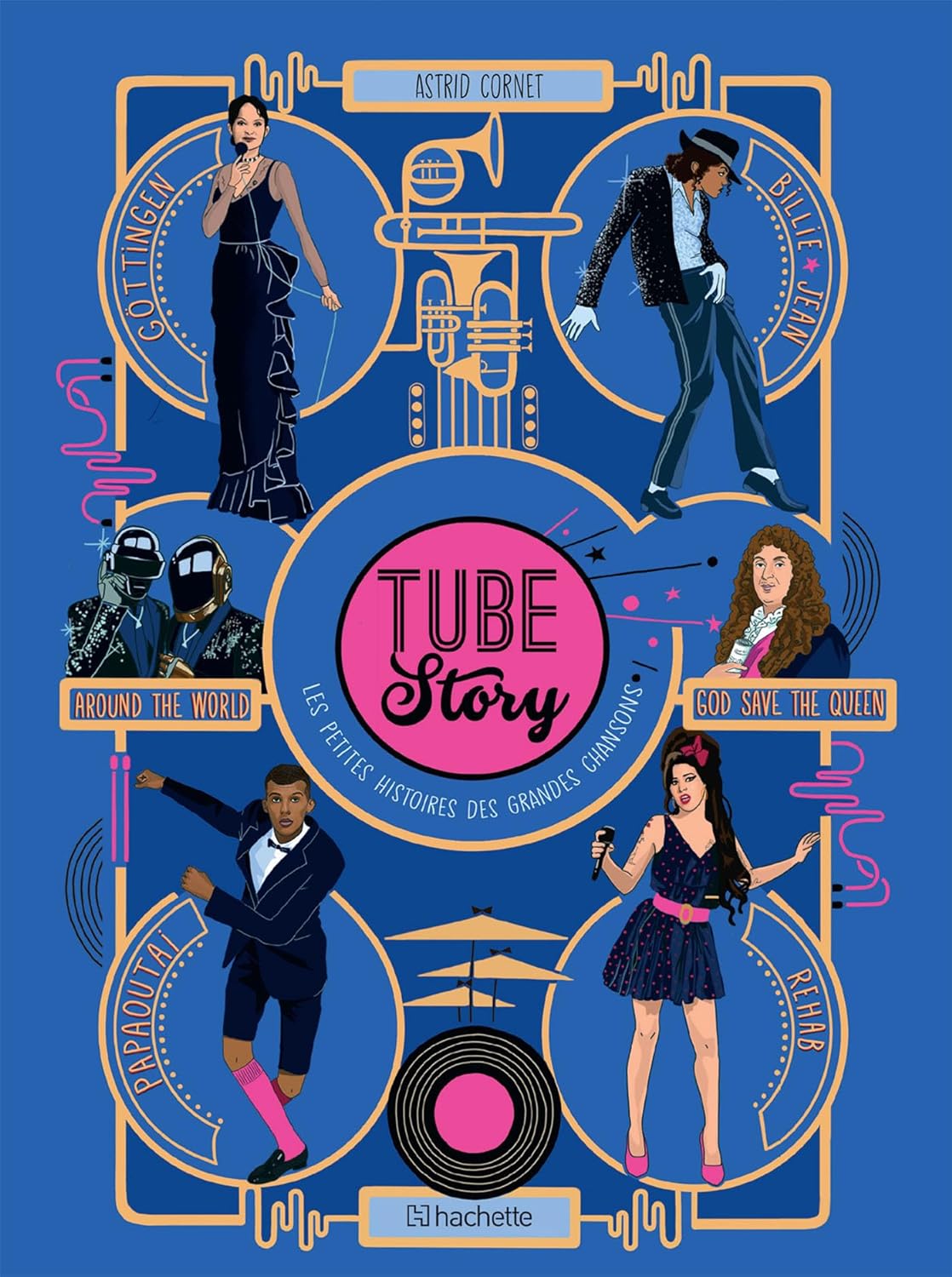Pour cette nouvelle retrospective, revenons sur la carrière de l’américain Alexander Payne. Downsizing, le boost de ce début d’année 2018 est l’occasion de revoir plusieurs films qui ont marqué le parcours du cinéaste. Réalisateur très discret et « peu » prolifique (7 films en 20 ans), ce diplômé d’Histoire polyglotte est né et a grandi à Omaha dans le Nebraska au sein d’une famille grecque très liée. A des millénaires d’une inclinaison artistique familiale -ses parents sont restaurateurs- le jeune Alexander a débuté comme scénariste pour la télévision. Il développe une plume assez satirique dotée d’un soupçon de vérité et entouré de légères nappes d’humour, qu’on retrouve dans l’intégralité de ses films. De Citizen Ruth (son premier long métrage à 35 ans !) à Downsizing, découvrons l’univers d’Alexander Payne.

Figure à part et à la fois bankable d’Hollywood, Alexander Payne appartient à cette nouvelle génération de réalisateurs qui a émergé dans les années 90. Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Kevin Smith, Richard Linklater, Payne… Une nouvelle vague, plus dynamique et indépendante voit le jour à la fin du XXème siècle. L’ogre Weinstein est le généreux mécène et supporter de ces nouvelles têtes qu’il va valoriser au sein de Miramax entre autres. L’ouvrage de Peter Bieskin, Sexe Mensonges & Hollywood, permettra d’aller plus loin dans les détails. La trentaine à moitié finie, Payne embarque dans une épopée cinématographique qui le mènera jusqu’aux Oscars quelques années plus tard, avec un premier long métrage co-écrit avec son colocataire de l’époque, Jim Taylor.

Citizen Ruth (1996) – 1er film
Pour une entrée en matière, Alexander Payne frappe les esprits. Premier film et déjà s’élaborent les « trucs » du réalisateur. Le métrage est correct et le réalisateur puise grandement (et judicieusement) dans la grammaire cinématographique pour son baptême du feu. Satire politico sociale, Citizen Ruth ouvre la voie à des oeuvres originales qui vont jalonner le parcours de l’américain.
Dès l’écriture on sent quelque chose de différent, le petit effet waouh qui caractérise certains cinéastes. On ne crie pas au génie mais à la marque de fabrique qui se dessine. Ruth Stoops, au quotidien dépravé gravitant autour de la drogue est une nouvelle fois enceinte. Elle, qui a déjà quatre enfants retirés par la D.A.S.S., se tourne vers l’avortement. Mais plusieurs personnages vont tenter de l’en dissuader….et de la convaincre à la fois. Elle qui n’était qu’un déchet humain devient soudainement le centre de toutes les attentions de la ville. Alexander Payne s’entoure de sa future plume de toujours, son pote Jim Taylor. Le duo signe une histoire drôle, acide, politiquement incorrecte et touchante. Un cocktail ambitieux qui prend sa forme dans l’interprétation juste et touchante de Laura Dern. L’actrice, alors au sommet de sa gloire, décide de jouer dans ce petit film indépendant de trois millions de dollars (c’est très peu dans le cinéma américain). Difficile de juger le travail de directeur de comédien de Payne tant Dern incarne parfaitement son personnage un peu bête avec certains moments de lucidité surprenants et émouvants.

Le public américain puis mondial vient de voir Payne dans ce qu’il sera plus tard : un conteur humaniste d’histoires originales et pleine de rebondissements. Car le scénario est déjà une forte valeur ajoutée à ce premier film. Payne/Taylor nous font suivre cette « anti-héroïne » au travers de situations du quotidien tournées de manière loufoque (on croit voir du Coen parfois) avec des retournements de situation inattendus (et d’autant plus plaisants quand ils arrivent !!). Ainsi, le paiement d’une caution de sortie de prison peut nous faire rire aux éclats alors que la détresse de la dépendance à la drogue arrive à nous sortir quelques larmes. Déjà, Payne a un message fort. Le dilemme de Ruth et la question de l’avortement est ici abordée de manière drôle mais le fond a beaucoup de substance et cette mayonnaise restera à tous les menus de Payne.
La musique est abordée comme un complément de la narration visuelle. Rolfe Kent débute ici une longue aventure avec Payne. La bande son est très discrète et sert souvent à sous-tendre le comique ou le dramatique de l’action. Pas d’artifice ostentatoire et l’effet marche sans sonner faux. On retrouvera cette utilisation de la musique dans l’intégralité des films de Payne. En revanche, Citizen Ruth est le seul film d’Alexander Payne qui soit une histoire originale portée par une héroïne. Le fait est assez stupéfiant pour que l’on s’y attarde. Payne fera tourner de magnifiques et talentueuses actrices certes, mais jamais plus en haut de l’affiche. Bien qu’il signe quasiment tous les scénarios de ses films, ces derniers seront tous des adaptations de livres et Citizen Ruth (et Downsizing) est donc la seule véritable histoire originale du duo Payne/Taylor (cela n’empêchera pas que son regard va souvent au delà des romans, pour le plus grand bonheur de tous). Et puis tout le monde ne peut pas se targuer d’avoir Burt Reynolds dans son premier long métrage !
Sideways (2004) – 4ème film et The Descendants (2011) – 5ème film

Après un drame bouleversant et touchant porté par le génial Jack Nicholson, About Schmidt (2002), attardons nous sur deux films pivots de sa carrière par bien des aspects.
Avec Sideways, Payne réitère son expérience d’adaptation de son film précédent – About Schmidt est librement adapté du roman éponyme de l’écrivain polonais Louis Begley (1997). Le livre du même nom de Rex Pickett tape dans l’oeil du duo de scénaristes qui s’attelle à le transposer au cinéma. Ce roadtrip viticole de deux quadras au carrefour de leurs vies, s’inscrit dans une thématique récurrente qu’abordera Alexander Payne dans tous ses films jusqu’à présent. Le héros sera toujours masculin, noyé dans une vie morose et pleine de contradictions (et surtout d’échecs amoureux inconscients) et décidera d’effectuer un virage à 180°. Un virage géographique également puisqu’on quitte enfin le Omaha, Nebraska natal du réalisateur pour des paysages plus ensoleillés (avant d’atteindre le paradis dans le film suivant). Ce 4ème film est surtout la confirmation d’un travail avec des personnes avec lesqelles Payne a l’habitude de travailler. La musique (Rolfe Kent), le montage (Kevin Tent), les décors (Jane Ann Stewart) et les costumes (Wendy Chuck). James Glennon étant parti prématurément, c’est Phedon Papamichael qui se charge de la photographie (et on ne parle ici que des principaux chefs de poste). Le signe d’une équipe en confiance et qui livre une recette efficace, fortement imprégnée d’une « marque de fabrique » = cette comédie dramatique qui jongle très judicieusement entre les deux tons.
Sideways est également le film qui fait découvrir Alexander Payne au grand Hollywood. Il récolte cinq nominations aux Oscars (les seconds rôles, la réalisation, le film et l’adaptation). Jim Taylor et Alexander Payne repartiront avec la dernière statuette. Une reconnaissance de la profession pour une plume assez atypique et très originale. Au bout de quatre films, l’américain arrivé sur le tard accède enfin à une relative reconnaissance qui le lancera sur des projets plus ambitieux.

Toutefois, on assiste à une coupure de sept ans avant son prochain film. Terrence Malick avait fait mieux (20 ans entre Les Moissons du Ciel et le retour en fanfare avec La Ligne Rouge). Cette longue absence prend toute sa valeur à la sortie de The Descendants, tiré du roman éponyme de Kaui Hart Hemmings (2007) que Payne a adapté sans son buddy Jim Taylor (qui passe à la production). A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à un accident de bateau, Matt King tente maladroitement de se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans vive et précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il doit vendre les terres familiales, les dernières plages tropicales vierges des îles, héritées de ses ancêtres hawaiiens. A la manière de Scorsese qui aime filmer New York, Payne nous fait voyager agréablement dans l’archipel d’Hawaï, sans jamais en faire trop, de belles images, une jolie lumière et ça suffit. Phedon Papamichael, son récent collègue chef opérateur dira même que le sensationnel n’est jamais recherché par Payne dans ses choix de cadres. Il aime raconter des histoires simplement, sans passer par des « plans signatures » ou techniquement complexes à mettre en oeuvre. Le résultat parle de lui même. Rolfe Kent fait également un travail remarquable sur la musique en intégrant des voix hawaïennes qui apportent la touche finale à une immersion crédible. Une adaptation fidèle à l’oeuvre originale qui repose essentiellement sur les décors et le casting. George en tête de peloton, ses filles à l’écran sont de vraies révélations. Shailene Woodley (que l’on retrouvera bien trop vite dans des blockbusters; malheureusement) offre une performance poignante de l’adolescente en charge d’épauler un père anéanti par les malheurs. Sa cadette Scottie est interprétée par une illustre inconnue qui n’avait jamais joué avant : Amara Miller. Pour son premier film avec des enfants, Payne montre une maîtrise d’expert sans tomber dans le pathos. Une des nombreuses facettes de réalisateur qu’il gère avec brio.
Côté scénario, on assiste encore à un drame d’un quadra, un peu pommé/dépassé par les événements, qui arrive à un carrefour de sa vie. Et ce cinéma qui parle de vrais êtres humains, ces personnages qui sont tellement monsieur tout le monde et tellement uniques dans leur caractérisation. Alexander Payne est un humaniste, on ne peut le cacher. Bien qu’il n’écrive rien ex nihilo, il s’attarde à choisir les bonnes histoires et les rendre encore plus atypiques avec son travail d’adaptation qui le fusionne avec le texte. Ça ne vient pas de lui, mais ce qu’il en fait et ce que l’on ressent est un vrai signe de qualité, qui perdure sur tous ses films. Sans doute est-ce le débat sur les terres que nous habitons et le respect des traditions v.s le profit du capitalisme que propose le livre qui a attiré son oeil. Ou alors les relations familiales et l’amour tout simplement. Il y en aurait tellement à citer dans ce film qui touchera le plus grand nombre par la richesse de la famille King.
The Descendants est un succès au box office puisqu’il nonuple sa mise de départ pour récolter presque 180 millions de dollars. Il rafle également le Golden Globe du drame et du premier rôle masculin. Nouvel oscar pour Alexander Payne avec l’adaptation (contre cinq nominations au total). C’est le plus gros succès commercial du réalisateur américain à ce jour (en attendant le « blockbuster » de sa carrière : Downsizing).

Nebraska (2013) – 6ème film
Sans doute le film le plus artistique et intime du réalisateur. C’est également le premier film auquel il ne consacre pas sa plume. Le scénario de Bob Nelson est tombé dans les mains de Payne alors qu’il tournait About Schmidt. Ses amis producteurs de ses premiers films Albert Berger et Ron Yerxa l’ont sollicité pour qu’il leur conseille un réalisateur si possible originaire du Nebraska et Payne leur a proposé sa propre candidature. Ils ont accepté en le produisant. Bruce Dern était le choix premier pour le rôle principal et il lut le script dès 2006 avant ce long trou dans la carrière de Payne. Dans Nebraska, il incarne Woody Grant un père septuagénaire insupportable, rabat-joie, alcoolique persuadé qu’il a gagné un million de dollars comme l’annonce cette publicité évidemment mensongère qu’il a reçue. Son entourage est désespéré par cet homme qui mûrit un Alzeihmer qui l’handicape de plus en plus. Son fils cadet, David Grant, décide de l’emmener à Lincoln, Nebraska où réside l’entreprise de loterie pour le sortir de son quotidien et renouer des liens père-fils qui n’ont jamais vraiment existé. Un road movie proche de Sideways et extrêmement touchant par des acteurs au sommet et une image à couper le souffle. Le duo que forment les parents June Squibb et Bruce Dern est délicieusement piquant; elle qui dit littéralement tout ce qui lui passe par la tête. Un vrai personnage de l’univers Payne.
Le choix du noir et blanc est inédit dans la carrière de Payne. Pas qu’il n’apprécie pas la technique, juste que les occasions ne s’étaient pas manifestées. C’est sans doute le film qu’il a travaillé le plus esthétiquement. Libéré de la contrainte de la couleur, son chef décorateur le temps d’un film, J. Dennis Washington, a travaillé en forte collaboration avec Phedon Papamichael (chef opérateur) pour que les décors soient fournis en textures. Wendy Chuck, sa chef costumière de toujours, a aussi apporté son expertise pour donner au final une image tellement symbolique que les tons de gris prennent le rôle de la couleur. Un exercice de style maîtrisé pour un réalisateur qui n’accordait pas énormément d’attention à l’image (toutes proportions gardées, il ne faisait pas une priorité d’avoir des plans sophistiqués et composés avec minutie). Nebraska propose une palette de plans de nature et urbains qui valent vraiment la peine. La lumière du chef opérateur est également efficace dans la structure de chaque plan. Pour terminer sur l’image, le film a été tourné avec une caméra haut de gamme (une classique à Hollywood dont on ne citera pas le nom), en cinémascope (utilisant des objectifs anamorphiques). Le résultat est bluffant par plusieurs aspects. Tout d’abord la qualité de l’image qui souligne les détails d’un visage (et vous combinez à ça les effets d’ombre et de lumière pour obtenir des bijoux visuels). Le choix du cinémascope permet d’immerger le spectateur dans des territoires vastes et renforce le mouvement des personnages dans ceux-ci. On voit beaucoup de plans larges, souvent utilisés sur le ton comique avec une mise en scène très simple (no cut) pour un effet encore plus efficace (saluer la performance des acteurs qui démontre que le mieux est l’ennemi du bien).

Nebraska est également une nouveauté scénaristique pour Payne. On ne suit plus un quadra perdu au carrefour de sa vie. Fort de son expérience sur le thème de la famille dans The Descendants, ce film développe une relation père-fils tumultueuse sous un registre toujours imprégné du cocktail Payne : du drame et de l’humour. On assiste sans doute à l’apothéose de l’ironie chez Payne. Un léger goût d’humour noir où le rire ne masque pas la gène qui nous saisit au même moment. On rit de la vieillesse mais on est soulagé d’avoir vu un film qui en parle de manière si brute et à la fois si réelle qu’on fait bien souvent l’autruche avec le quotidien des « anciens ». Un film très humaniste une nouvelle fois où Payne nous montre qu’il fait d’excellents métrages qui parlent d’êtres humains, plus dans leurs travers que sous leurs bons jours.
Ce film est un succès critique alors que le public ne suit pas vraiment. Toutefois, Payne et sa troupe de techniciens repartent avec quelques récompenses puisque le film est présenté en Compétition au Festival de Cannes et Bruce Dern repart avec le prix d’interprétation masculine, logiquement. Alexander Payne a offert le rôle de sa vie (à 77 ans) au père de sa première actrice, Laura Dern. Nebraska est sans doute le film le moins accessible de sa carrière (beaucoup se figeront déjà, à tort, devant le N&B). Mais c’est surtout un film très silencieux, doté d’un excellent rythme et de dialogues interprétés avec beaucoup d’émotion, sans fausse note. Certains le qualifieront de film d’auteur et la comparaison est loin d’être fausse. Quoi qu’il arrive, Nebraska est le meilleur pour la rédaction.

Downsizing (2018) – 7ème film
Pour 2018, Alexander Payne fait péter sa cagnotte pour nous offrir ce petit objet de dystopie/science fiction très très symbolique. Le réalisateur sera le premier à le dire, Downsizing est une comédie, on s’y oppose, mais le film amène tellement de nouvelles idées et de remise en question de notre société qu’il en devient presque une satire sociale et politique. Tout nouveau dans la bande, Matt Damon incarne Paul Safranek un habitant d’Omaha (retour à la maison) qui se décide avec sa femme à tenter le downsizing, processus qui rétrécit la taille mais augmente le niveau de vie, pour commence une vie meilleure au soleil.
Alexander Payne s’essaie à un nouveau genre pour lui dans une histoire issue de l’imagination du solide duo Payne/Taylor. Voilà l’explication du trou de sept ans pendant lequel les deux compères ont planché sur le scénario. La boucle est bouclée avec Citizen Ruth. Voici le second scénario original du réalisateur et ça valait le coup d’attendre. De belles surprises au casting (Hong Chau un nom à retenir), un scénario à rebondissements et ce subtil humour noir qui délivre des messages forts de manière très élégante et comique. Un pur produit Payne !
En salles le 10 janvier 2018.