Chaque année l’éternel débat est remis sur la table : la Palme d’Or est-elle méritée ? Parmi les vingt films en compétition (et pas compétition officielle, c’est la sélection qui est officielle), on dénombrait pas moins de treize nationalités différentes. Alors que le poignant et puissant 120 BPM devait logiquement être l’heureux gagnant, le jury présidé par Pedro Almodóvar a surpris tout le monde en récompensant le film suédois The Square. Focus !
Dénoncer avec humour
Déjà auréolé du Prix Un Certain Regard sur la Croisette en 2014 pour Snow Therapy, le presqu’inconnu Ruben Östlund revient en 2017 avec une comédie très noire, cynique, pamphlet de la société moderne. Ce film est à voir au trente-sixième degré, tant tout est dans la dénonciation indirecte et subtile. C’est d’ailleurs assez rare de voir des drames « comiques » à Cannes. On a peut-être une partie de la réponse à notre question en introduction. The Square s’attaque au monde de l’art (mais pas que). On y voit un enchaînement d’œuvres tout aussi singulières que dérangeantes. Il faut y voir une transposition du scénario car ces œuvres ont été créées spécifiquement pour le film. N’allez pas y voir du placement de marque ou d’artiste. A l’image de ces tas de gravier, Ruben Östlund dénonce l’absurdité de vouloir faire de l’art avec n’importe quoi. La critique est acerbe et même Christian (le conservateur du musée) est sceptique devant les pitchs de conseillers experts en marketing. Ce couple de « jeunes cadres dynamiques » est une vraie réussite, nous y reviendrons plus loin. L’extase gratuite et bourgeoise devant cet art atteint son paroxysme avec l’oeuvre éponyme au film : The Square. Cette oeuvre existe vraiment. Elle a été présentée par le réalisateur au Vandalorum Museum, dans le sud de la Suède. La plaque de présentation de l’installation artistique donne le ton du film.

The Square est un sanctuaire où règnent confiance et altruisme.
En son sein, nous sommes tous égaux en droits et en devoirs.
Utopie d’une case où tous les gens à l’intérieur seraient égaux ? Ou dénonciation des « cases » qui régissent les individus ? L’ambiguïté du principe est dans l’esprit de The Square. Il va confronter le héros à divers conflits qui appellent une remise en question de nos actes au quotidien. Le rapport à l’image est une pierre angulaire du film. On est en recherche permanente (et plus ou moins volontaire) de « faire le buzz ». Snapchat et les autres réseaux sociaux ont majoritairement contribué à ce renouveau en communication (pour aller plus loin dans cette thématique, filez voir Ingrid Goest West qui se focalise sur Instagram). Le musée a besoin d’un rayonnement médiatique pour survivre, peu importe la manière dont l’exposition est présentée. La dérive est donc celle d’un modèle marketing qui atteint les limites de l’éthique dans la volonté de créer du conflit. Car pour certains personnages ce qui marche c’est la polémique.

La scène de la réception mondaine va surement devenir culte dans les années à venir. Dans un lieu grandiose, chic et très pompeux, un homme défile devant une assemblée ébahie et curieuse en incarnant un primate. La performance de Terry Notary est sublime. Enfin le public découvre son visage. Depuis 2009, cet acteur américain a incarné entre autres des gobelins dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, Rocket dans la nouvelle édition de La Planète des Singes. Il est également et surtout chorégraphe et c’est à lui que l’on doit le réalisme de ces êtres monstrueux. A visage découvert, il arpente la foule des humains en ridiculisant ce gratin pathétique. L’ambiguïté de la scène apporte un malaise génial et coupable. Quand les rôles sont inversés, la pilule a du mal à passer. Filmée simplement, la gestuelle des acteurs et la caméra de Fredrik Wenzel suffisent.

Derrière la fiction, la réalité
Pour écrire The Square, le réalisateur n’a pas hésité à piocher dans les événements de sa vie. Le vol de téléphone dans la rue ainsi que le journaliste atteint du syndrome de la Tourette sont « inspirés de faits réels ». Ces petits couacs du quotidien viennent alimenter un récit assez banal sur sa forme mais qui touche du doigt des problématiques sociales avérées. Comment réagit-on face à la mendicité dans la rue, alors que nous « compatissons ». Peu prennent un moment pour s’arrêter. Un père divorcé en pleine crise de la quarantaine, on ne pouvait pas mieux faire pour que le public s’identifie. Toutefois, on ne s’arrête pas au simple cliché. Les personnages sont souvent poussés à bout d’une situation déjà très cocasse et dès lors, leurs choix sont porteurs d’un mal-être. Même dans la Suède providence qu’on nous présente à la TV, le racisme et les ségrégations basées sur la réussite sociale sont légion. On vit déjà dans des cases…
Les médias en prennent pour leur grade avec un triste constat sur la diffusion de contenu sur Internet. On balance des infos en masse sans filtre, dans une stratégie aveugle et lucrative, où les statistiques permettent de briser la glace.Les bobos dansent au boulot sur une EDM musicalement pauvre. Toutes ces vérités sont présentées de manière absurde. Au final, le réalisateur met en scène des personnages statiques, à l’aise dans une vie confortable au matérialisme devenu insipide car habituel et acquis. L’élément déclencheur du film réside dans le vol du téléphone portable du héros. La perte de cet être cher est la motivation principale du personnage alors qu’il pourrait s’occuper de ses admirables filles…

Beaucoup de thèmes classiques sont abordés dans le film. En revanche la richesse des dialogues et l’originalité des situations le sortent du lot. On nous montre certaines actions que l’on ne voit pas dans les films de ce genre – on rit encore de l’intervention du chef pour présenter son buffet. Pas voire peu de musique extra-diégétique. Le réalisateur se sert de musiques existantes dans la culture populaire pour leur donner un sens à chaque fois particulier. Il prend la matière existante et l’inscrit dans une situation dramatico-burlesque. Le réalisateur ne cherche pas à casser les règles et pioche avec intelligence dans les moyens véhiculés par le cinéma. Il s’entoure d’acteurs et d’actrices efficaces et justes.
Pour en revenir à la question d’introduction, The Square possède tous les attributs du favori à la Palme d’Or. Une barre de rire satirique et social qui dénonce une société malade qui a perdu le goût de la vie. Le traitement par la satire et l’absurde constitue un élan de fraîcheur (non novateur mais trop rare) qui nous sort des drames pathos, mêmes très réussis. Le traitement systématiquement dramatique des problèmes sociaux conforte à ranger ces films dans des cases. Le public juge et classe vite (tout comme il consomme de l’information à la vitesse de la lumière). The Square est un pari risqué en France car il s’agit d’un film suédois / Palme d’Or. Mais le point de vue adopté, la diversité et l’originalité du traitement des situations sont intéressants. Une approche qui va à l’encontre d’une production française encore trop « politiquement correcte ». La comédie française populaire devrait en prendre de la graine et accorder plus de liberté à ses auteurs/réalisateurs. On pourra se « plaindre » que la mise en scène ne soit pas assez « cannoise » dans sa prise de risque artistique. Toutefois le film dégage sa propre saveur, sa propre ambiance qui est cohérente pendant 2h20. Il s’agit d’une belle découverte de cinéma réalisée par un homme engagé qui n’a pas la langue dans sa poche ! Bien qu’on aurait voulu voir les équipes de Robin Campillo et de 120 BPM palmées, on comprend mieux le choix d’un jury plus sensible et plus proche d’un conservateur de musée que des membres d’Act Up Paris. Ça fait partie du jeu, au déplaisir de son président Pedro Almodóvar.

The Square, malgré quelques longueurs, nous bouscule à chaque scène. Les différentes situations font toutes écho à une vérité et on en ressort avec un bizarre sentiment de malaise. Ces pensées sont souvent le signe d’un grand moment cinéma. La dénonciation peut aller au-delà des œuvres dans les musées. L’entreprise de la création d’art est inévitablement motivée par une volonté d’expression, de poser un point de vue (les Parisiens pourront en témoigner en découvrant Domestikator de l’artiste néerlandais Joep Van Lieshout, actuellement sur le parvis de Beaubourg). Ruben Östlund le fait admirablement au travers du 7ème art. Ken Loach a écrit un drame du point de vue d’un ouvrier au chômage l’an dernier dans I, Daniel Blake. Cette année, le message passe sur un ton plus léger, en ridiculisant une classe bourgeoise. Palme d’Or contestée, mais Palme en partie méritée.
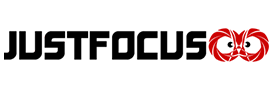






























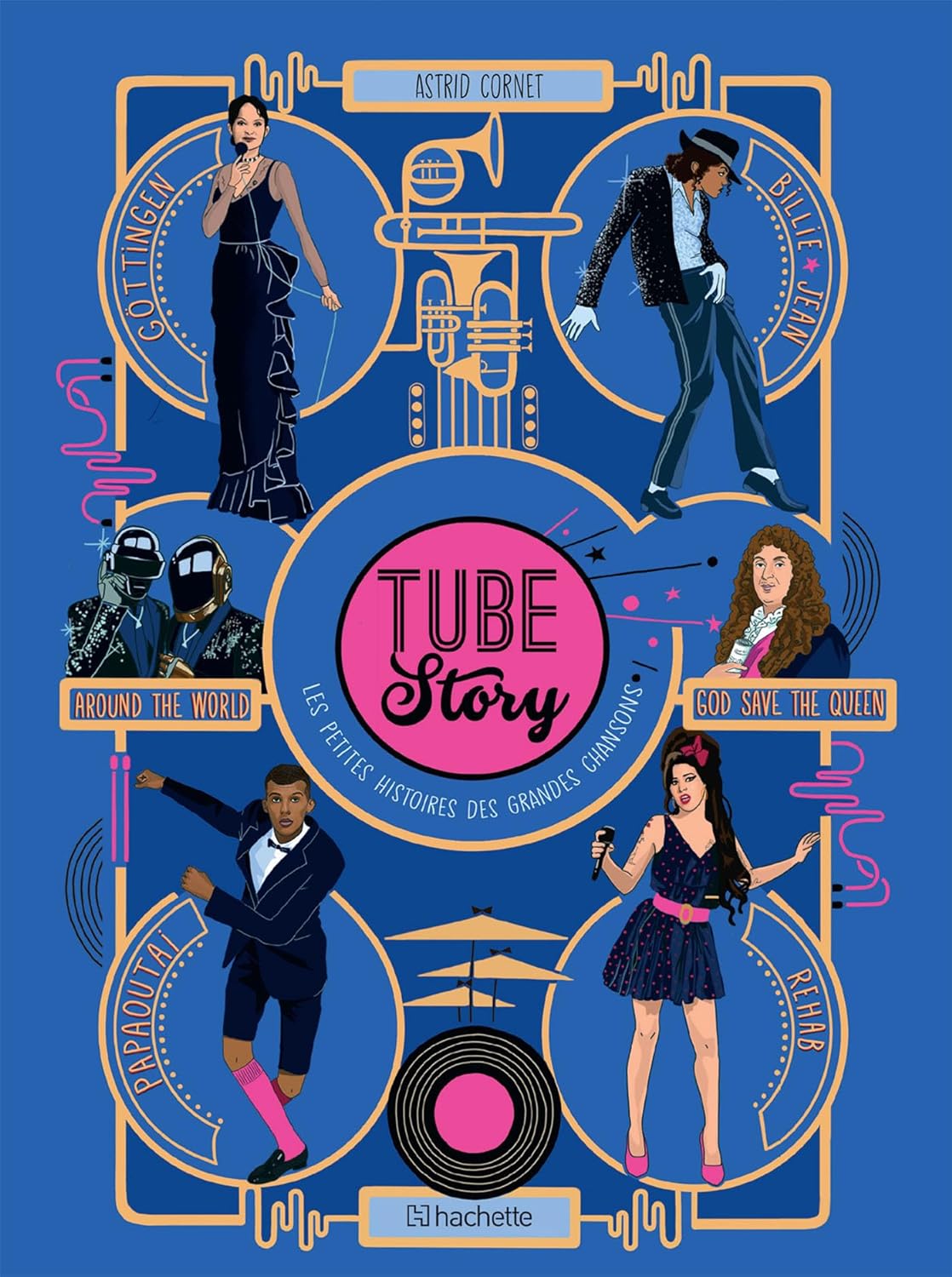



![[Report] Sciences Frictions à la Cité des Sciences – Expérience réussie](https://www.justfocus.fr/wp-content/uploads/2017/04/IMG_7102.jpg)



