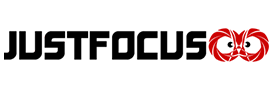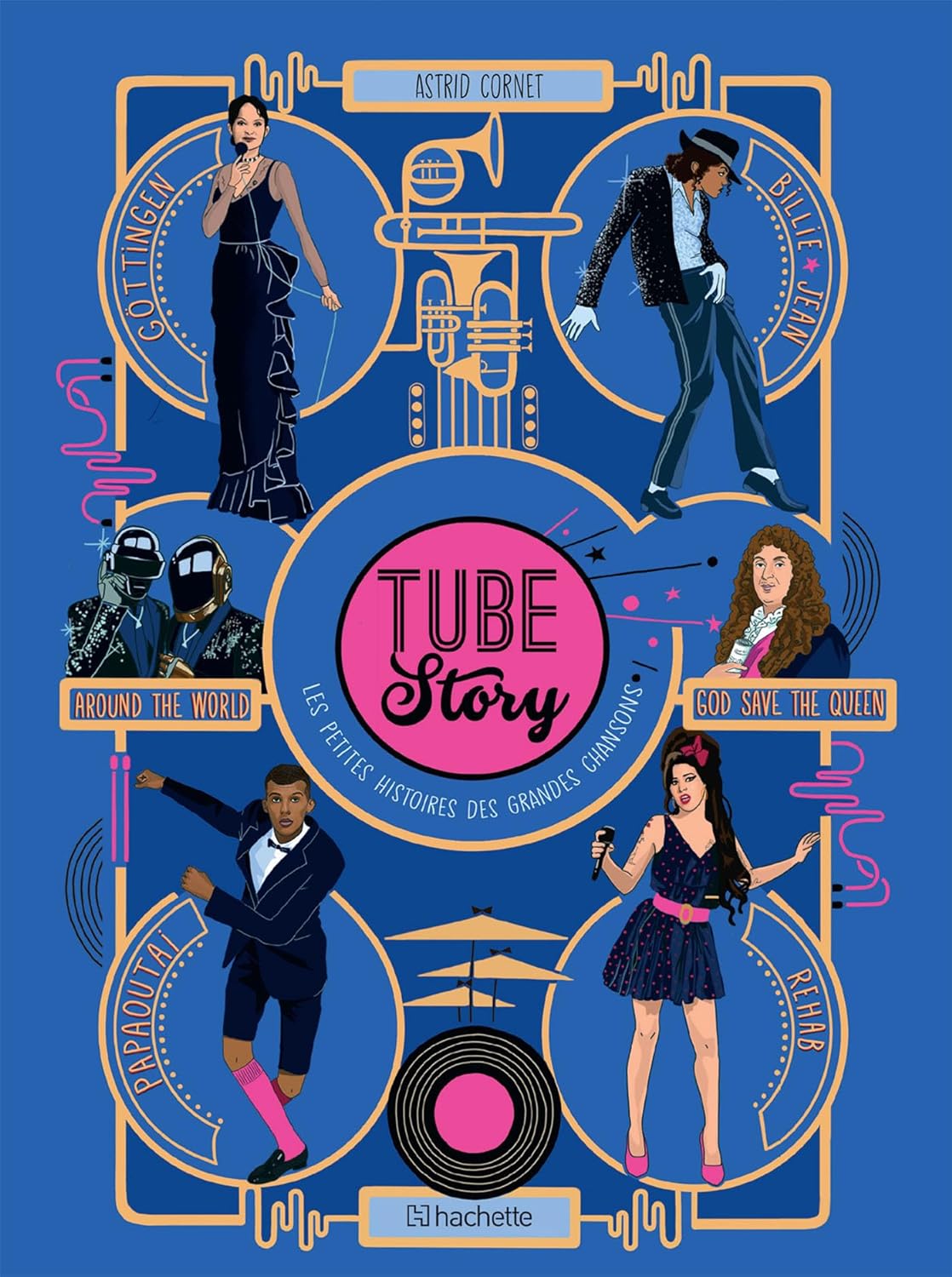Chaque été depuis quelques années, nous avons l’occasion de redécouvrir les salles des Champs-Élysées grâce au Festival du Cinéma indépendant des Champs-Élysées. Ce festival permet de mettre en lumière des œuvres cinématographiques souvent condamnées à rester peu distribuées ou invisibles. C’est une occasion unique de découvrir des films d’auteurs débutants ou méconnus, qui osent l’expérimentation et s’opposent au cinéma plus grand public. Parmi cette programmation riche et varié nous concentrer sur trois longs-métrages de fiction que nous avons découverts lors de ce festival.
Jour 1 : Il pleut dans la maison de Paloma Sermon-Daï
Il pleut dans la maison est le premier long-métrage de fiction de Paloma Sermon-Daï (je tiens à souligner qu’elle avait déjà réalisé un premier long-métrage documentaire récemment sorti, intitulé « Petit samedi »). Ce film est une nouvelle pépite ajoutée au catalogue du distributeur Condor, l’un des distributeurs les plus intéressants de ces dernières années. L’histoire se déroule pendant un été et suit les personnages de Purdrey et Makenzy, interprétés par deux jeunes acteurs talentueux qui sont en réalité frère et sœur dans la vie. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes et tentent de trouver des solutions pour améliorer leurs quotidiens.
Le style de Paloma Sermon-Daï peut être qualifié de naturaliste : on reconnait par exemples certaines similitudes avec des films tels que La vie de Jésus de Bruno Dumont, bien qu’il est facile de comparer tout film se passant dans des villes ayant des maisons construites avec des briques rouges au cinéma de Dumont. La caméra est principalement portée à l’épaule, mais reste calme. Les plans sont longs et souvent en mouvement, créant une sensation étrange de dichotomie : les personnages sont actifs, parlent rapidement et échangent des répliques percutantes, mais il y a peu de gros plans.
Les personnages de Il pleut dans la maison sont constamment associés à leur environnement, qui les oppresse peu à peu comme une prison à ciel ouvert. Les dialogues et le jeu des acteurs sont d’abord amusants, mais on comprend rapidement qu’ils sont écrasés par quelque chose d’invisible. Par exemple, il y a cette scène où Purdrey, qui fait du ménage dans des Airbnb pour gagner sa vie, nettoie une fenêtre tout en observant en silence une famille de touristes paisibles en train de vivre un moment de bonheur qu’elle ne semble pas connaître. Pas de mots. Seulement un visage qui se décompose, un corps qui interromps tout mouvement.
Il pleut dans la maison n’est pas simplement un teen movie. C’est un film remplit de colère, bien que cette colère reste discrète. Paloma Sermon-Daï ne montre que rarement les explosions de colère ou les confrontations. Ces moments semblent se dérouler hors champ, coupés du film au montage, dans le but de privilégier la pudeur et l’ellipse. Les tournants dramatiques majeurs se produisent ailleurs, invisibles mais présents, tels un plafond de verre que les personnages cherchent à briser. Ce plafond les écrase, les étouffe, et nous espérons ardemment que ces frères et sœurs réussiront à le surpasser.
Jour 2 : La Bête dans la jungle de Patrick Chiha
Deuxième film découvert lors de cette compétition, La Bête dans la jungle est un film diurne, hypnotique et lent qui divise. Pour notre part, nous sommes restés bouche bée en voyant le résultat du troisième long-métrage de Patrick Chiha. L’histoire suit May et John (Anaïs Demoustier et Tom Mercier), deux jeunes gens qui se rencontrent en boîte de nuit. John cache un secret et attend qu’une chose incroyable lui arrive. May décide de lui faire confiance et le suit, dans l’attente d’une aventure qui tarde à se concrétiser.
Le film se déroule sur plusieurs décennies, principalement dans un décor unique, une boîte de nuit qui évolue au rythme des changements musicaux de chaque nouvelle génération. Les personnages principaux semblent quant à eux être des sortes de vampires, traversant les époques tels des créatures de la nuit, insensibles aux ravages du temps.
Au début, Patrick Chiha tente de séduire le spectateur avec une esthétique flamboyante, une photographie très colorée et de nombreuses références cinématographiques. Cependant, quelque chose ne va pas. Il n’y a pas de plans larges capturant l’énergie des danseurs de boîte, pas de mouvements de caméra fluides. Au contraire, la caméra est souvent statique, ce qui rend le cadre de plus en plus étouffant.
La Bête dans la jungle transforme ses deux personnages principaux en spectateurs de cinéma, témoins de la vie qui défile sous leurs yeux. Les personnages secondaires vieillissent, à l’inverse de John et May, observant la fête de loin, refusant d’y participer mais fascinés par sa beauté. Pourtant, tout cela se dégrade. L’épuisement de ce couple platonique devient de plus en plus visible à l’écran. Les couleurs s’estompent après un dernier baroud d’honneur monochrome évoquant l’expressionnisme allemand. L’argentique et la couleur cèdent la place à la froideur du numérique. La Bête dans la jungle est un film épuisant, réalisé par un cinéaste qui semble lui-même épuisé par l’évolution du cinéma, art qui semble s’affadir, disparaître sous l’excès d’un réalisme factice qui remplace le faux tapageur, mais qui est pourtant plus réel que jamais.
Jour 3 : Rotting in the Sun de Sebastiàn Silva
Sebastiàn Silva, un cinéaste méconnu en France, compte pourtant déjà une carrière bien remplie avec sept longs métrages à son actif, dont seulement trois ont été distribués en salles en France. Pour être honnête, il s’agit du premier film de cet auteur que j’ai pu voir. Découvrons-le donc.
Rotting in the Sun peut dérouter. Nous suivons un personnage déprimé et en surpoids, une version amplifiée et exagérée du réalisateur lui-même, égaré, toxicomane, obsédé par le suicide et qui essaie de retrouver un peu de joie de vivre en passant un séjour dans une plage naturiste fréquentée par la communauté gay. Pourtant, notre personnage se sent à l’écart. Incapable de faire autre chose qu’observer des scènes très explicites, il semble mélancolique et exclu. Nous sommes rapidement confrontés à une confrontation presque méta : le cinéma contre les réseaux sociaux. La fête, souvent associée au monde du cinéma, est ici représentée par les influenceurs des réseaux sociaux. Le cinéma, personnifié par Silva, est mortifère, tandis que les influenceurs, notamment représentés par Jordan Firstman, une personnalité très populaire sur les réseaux sociaux aux États-Unis, sont hyperactifs.
Pendant la première moitié du film, nous avons l’impression d’assister à une sorte d’égo-trip à la Almodóvar ou à la Nanni Moretti, mais Silva disparaît ensuite de son propre récit. Que lui est-il arrivé ? Sans vouloir spoiler, nous pouvons peux dire que Rotting in the Sun s’éloigne des préoccupations des artistes aisés pour se concentrer sur des personnages modestes, basculant peu à peu vers un thriller Hitchcockien. Cela permet à Sebastiàn Silva de livrer un film plutôt modeste, amusant, outrancier et assez malin par-dessus le marché.