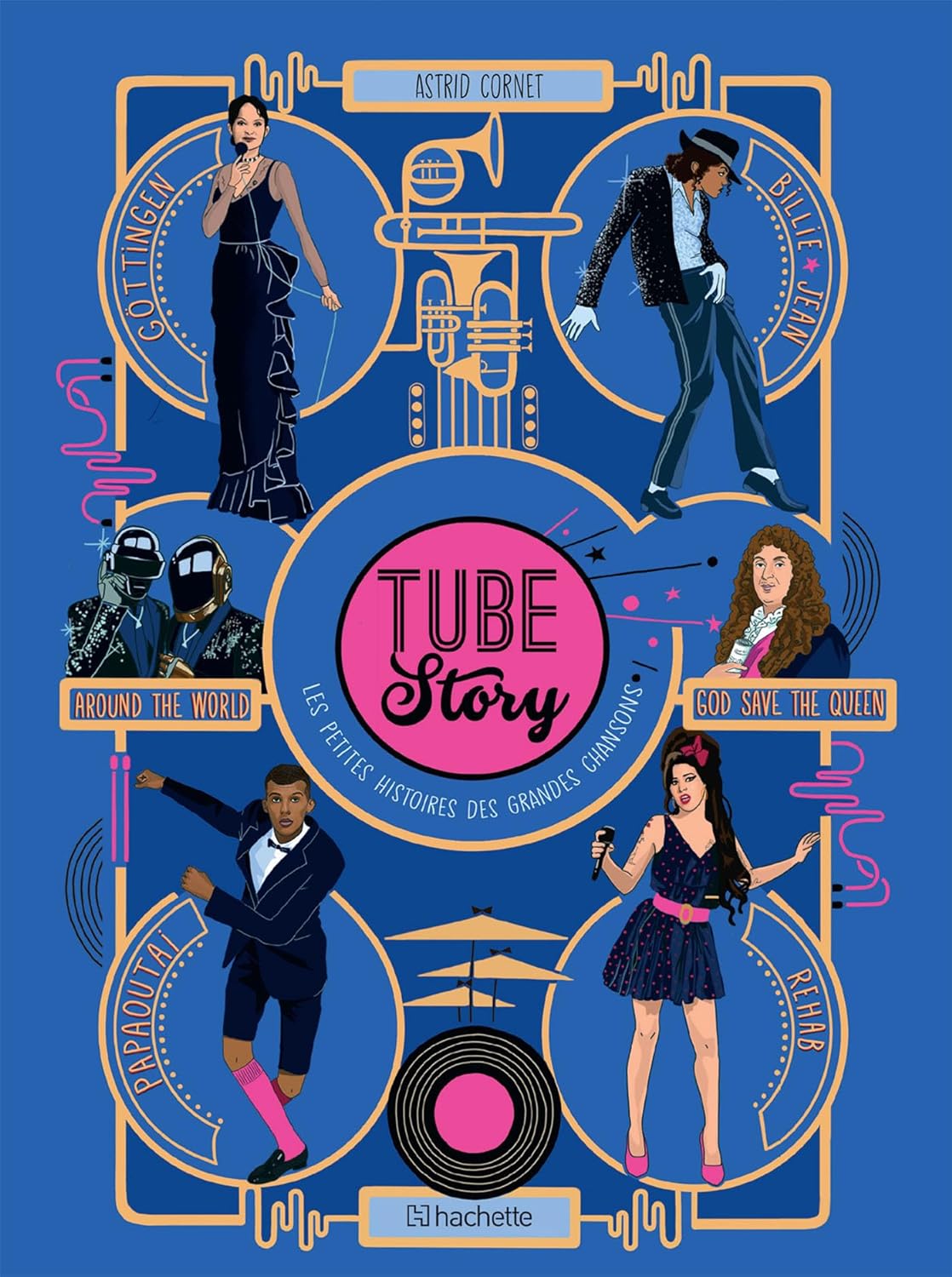L’écrivain signe son retour au cinéma, avec l’adaptation du Quai de Ouistreham de Florence Aubenas. S’il en reprend l’aspect documentaire, sa visée s’étend également sur le travail de l’auteur et s’inscrit comme une mise en abyme de la condition d’écrivain. Mais l’apport de la fiction au sein d’un pamphlet social n’est-il pas contreproductif, voire nonsensique ? Éléments de réponse.
Ouistreham : quasi documentaire, jamais social
Voilà déjà plus de 10 ans que la brutalité du Quai de Ouistreham résonne dans le cercle littéraire. Son autrice, Florence Aubenas, journaliste grand reporter connue pour sa plume précise au Kosovo, en Afghanistan ou en Irak, l’a écrit comme un récit autobiographique. L’objectif, partir dans une région stigmate de la crise de 2008 pour y relater la misère économique, sociale et humaine. Elle choisit la terre normande et l’agglomération de Caen, où elle s’invente une vie de jeune divorcée, sans expérience et prête à faire le moindre boulot précaire pour subsister.
Son expérimentation l’amènera sur le ferry qui joint Ouistreham et Portsmouth, aussi appelé « l’enfer » pour ses conditions de travail inhumaines. Cette enquête, aux mots forts, crus et profondément sociaux, s’est faite miroir d’une époque encore jamais révolue. Où la pauvreté des territoires est une triste réalité, où la subsistance est un destin de vie, au lieu du dernier recours.
Nombreux sont les studios qui ont voulu transformer cet essai sur pellicule. Florence Aubenas a toujours lutté contre. Il a fallu l’investissement et toute la persuasion de Juliette Binoche auprès de l’écrivaine pour qu’elle accepte le projet. Les deux femmes désignent un cinéaste qui accepte sans trop comprendre cette nomination : Emmanuel Carrère. Ex critique de cinéma pour Positif et Télérama, romancier et documentariste, l’homme est curieusement tout trouvé pour cet exercice fastidieux. Dans son œuvre littéraire (D’autres vies que la mienne, Yoga), l’auteur n’hésite pas à mettre en abyme (et de surcroit, questionner) sa condition d’écrivain, en se projetant dans ses récits.
Il décide même d’adapter sa propre œuvre de fiction avec succès, avec La Moustache. Dans Ouistreham, il n’est pas question d’un documentaire social ou d’une transposition romancée, mais plutôt de la fusion de ces deux concepts, à travers un métrage très réaliste, mais qui prend énormément d’aises par rapport à l’ouvrage.

Ouistreham démarre toutefois comme ce dernier. Florence Aubenas devient ici Marianne Winckler, présentée comme écrivaine, pas vraiment comme journaliste. La quinquagénaire s’installe dans une piaule miteuse, à peine plus grande qu’un débarras. Le récit démarre avec la lecture de son propre texte sur ordinateur, nous expliquant sa volonté d’être au plus proche de la vie réelle, d’être au contact de la « vraie » misère. S’en suivra pendant les 100 prochaines minutes les pérégrinations de Marianne pour survivre, se travestissant au milieu d’un corps social prolétarien qui lui était jusqu’alors inconnu.
Une transposition soignée dans la forme
Pour retranscrire cette odyssée, Emmanuel Carrère fait fit de toutes exagérations de style. Les coups de caméra sont d’une simplicité et d’une limpidité confondante. Beaucoup de plans fixes, avec des cadres très resserrés pour (littéralement) coller à l’humain. À cela s’ajoute un travail esthétique quasi documentariste. Le cinéaste l’admet dans plusieurs interviews, il souhaitait être « fidèle » à ce point de vue adopté par Florence Aubenas dans son livre.
De ce point de vue, Ouistreham est un film précis dans les éléments qu’il daigne nous montrer. Une attention a été portée sur les situations et les décors, nous dévoilant une belle dualité symbolique : la captation paraît aussi juste qu’hypocrite, Juliette Binoche étant peu crédible en technicienne de surface pour des locaux de start-up aussi sales que l’esprit de leur gestionnaire. Mais le geste est légitime. Il reprend un détail factuel : Florence Aubenas n’était pas plus douée pour le ménage qu’une des plus grandes actrices françaises.
Il y a là-aussi l’idée d’une mise en abyme d’Emmanuel Carrère sur le rôle de l’écrivain et du journaliste. Jusqu’où doit-il aller pour relater les faits avec précision ? La légitimité vient-elle forcément du vécu ? Ou pire : peut-on vraiment relater d’un problème de classe qui n’est pas le nôtre ? Se définissant comme bourgeois, Carrère a de facto un terrain de jeu idéal et cette grille de lecture est tout à faire pertinente à la vision du film.

D’autant que le réalisateur se fend de choix tranchés tout au long de ce dernier. Exit ainsi des scènes primordiales du livre, comme la manifestation des ouvriers dans Caen (peut-être trop démentielle et hors budget), l’accumulation des petits boulots qui rythmaient la narration devient ici de petites scènes de transition ou encore les séquences sur la galère d’argent (avec des chiffres noirs sur blanc) occultées.
Pire (ou pourquoi pas, question d’approche), le sens de certains passages sont modifiés. Dans le Quai de Ouistreham, l’équipe de ménage du ferry s’accommode d’un pot de départ express pour l’un de ses membres, remercié par leur employeur. Ouistreham renverse le rapport de force et montre une équipe heureuse, fêtant tranquillement le futur nouveau travail de cette jeune femme qui aura fait sa dernière tournée dans le ferry.
Où est la vraie misère ?
Aux premiers abords (ou si on n’a pas lu le livre d’Aubenas), ces choix de script ne perturbent guère le visionnage. Le long-métrage trouvant son rythme à travers des séquences efficaces quoiqu’un peu répétitives (le ferry prenant trop de place) et joue beaucoup sur les relations qu’entretiennent les personnages. Chose que l’autrice avait moins relatée, relayant avec distance sans s’autoriser d’émotions, retenue journalistique oblige, pour rester maître de ses mots.
Par pur radicalité, Emmanuel Carrère s’y oppose et invente le personnage de Christèle (formidable Hélène Lambert, ancienne agent d’entretien et actrice non professionnelle), qui devient la meilleure amie de Marianne Winckler. Elle a des enfants, rêve de gagner au loto pour « une paire de pompe à 300 € et un tatouage », tube ses cigarettes pour économiser. Cet ajout scénaristique (en collaboration avec sa compagne, Hélène Devynck, récente témoin de l’affaire PPDA), le cinéaste en fait le cœur de son film. L’adage veut que ce qui s’oppose s’attire et dans le cas suivant, la rencontre entre Marianne et Christèle est un boom émotionnel et humain qui viendra casser le regard de l’autre sur sa vie respective.

C’est toutefois la grande interrogation qui subsiste dans Ouistreham. Face aux faits, Emmanuel Carrère semble préférer l’humain pour justifier du caractère symbolique du combat de Marianne. D’ailleurs, les rares éléments repris tels quels de l’ouvrage, en dehors de son décorum, sont des petits instants de vie, peut-être les plus attachants : Cédric (Philippe pour Aubenas) qui déballe ses techniques de drague et ses rêves de camion à pizza ou encore la formation ménage avec un cours sur le nettoyeur monobrosse surnommé « la Bête ».
Au final, le seul point d’intrigue potentiel (va-t-elle se faire griller ou non ?) est éludé au bout de 10 minutes de film (et même dans la bande-annonce), puisque Marianne est démasquée par sa conseillère Pôle Emploi. De même, la conclusion du roman (une proposition de CDI, synonyme de fin de l’expérimentation) devient tout autre et même un peu ridicule.
Avec Ouistreham, le cinéaste s’intéresse à autre chose, en donnant à voir une variation plus humaine, mais forcément moins pertinente d’une bombe sociale. Peut-on romancer la pauvreté et la misère, tout en faisant un rendu documentaire ? Selon Carrère, c’est oui. Ainsi, il privilégie l’émotion quasi frelatée, quand il aurait pu accoucher d’un véritable appel à la révolte. Il y a de quoi y voir un travail intéressant de mise en abyme, mais un échec en termes de représentation sociale. Un comble pour un tel sujet et surtout, par rapport au livre qu’il adapte.
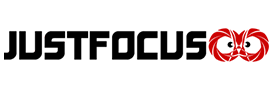




















![Sum’One sort la pépite électro Let It Snow et le EP Hello Vera Sum'One - Let It Snow [Official Video]](https://www.justfocus.fr/wp-content/uploads/2024/11/SumOne.jpg)