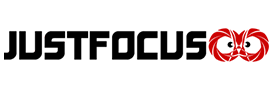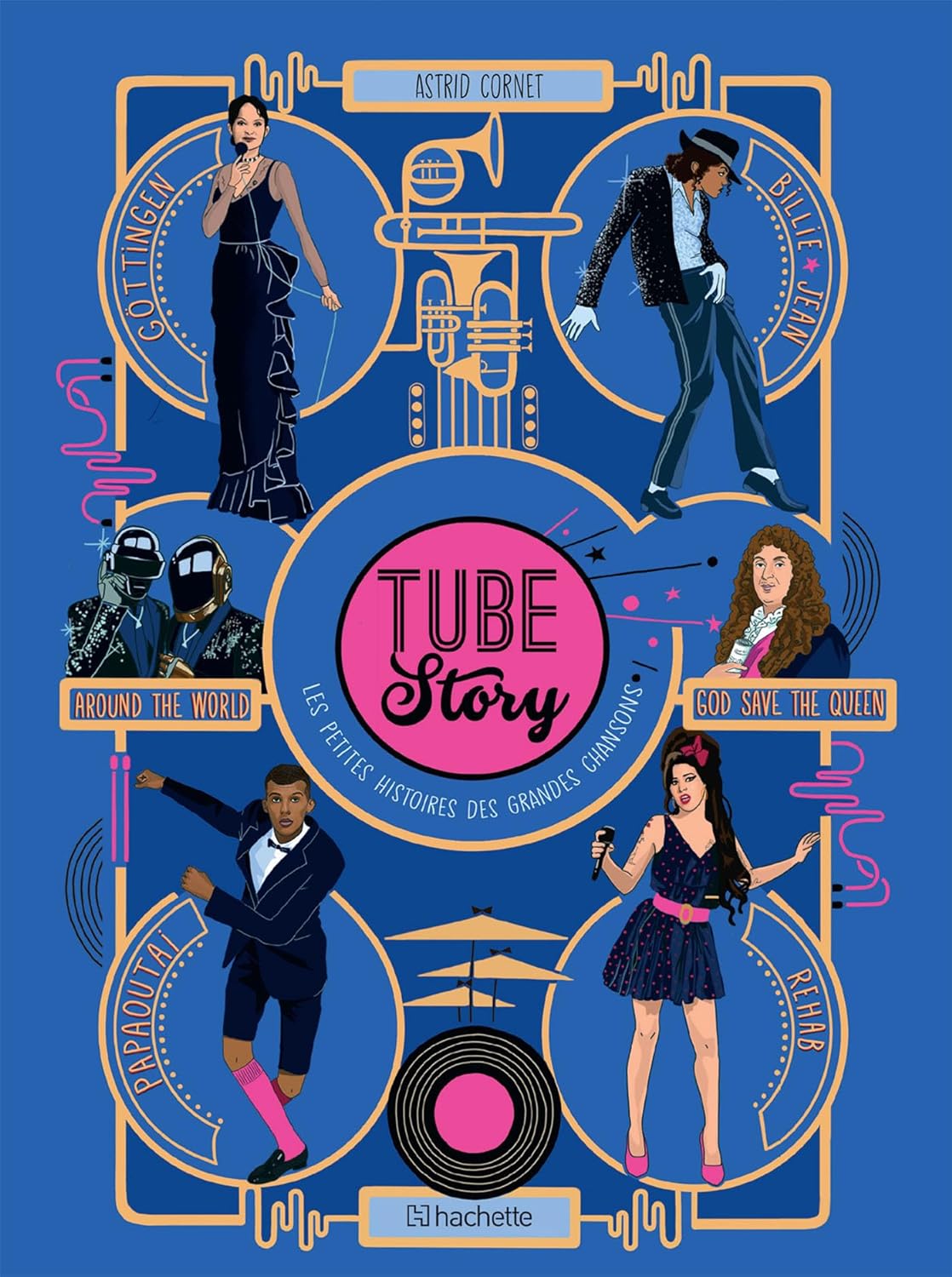Candidat malheureux à l’Ant-Man de Marvel dont il aura assuré la gestation pendant plus de dix ans, Edgar Wright n’aura pas attendu que la poussière retombe pour embrayer sur Baby Driver, projet éminemment personnel puisque alliant déjà sur le papier tout le crédo de son cinéma entre sens du rythme et omniprésence musicale. Une musique d’ailleurs à la base du projet, car derrière son postulat classique de chauffeur mafieux qui souhaite raccrocher, Baby Driver se révèle être surtout un film drivé par l’outil musical, ici véritablement à l’aune de toute la mise en scène. Autant dire une gageure dont sort pourtant vainqueur Wright, qui fidèle à son style survolté, sort un film mené tambour battant et furieusement cool !
Du cool, ce n’était pourtant pas ce qui manquait dans The World’s End (Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde) sorti en 2013. Mais là ou beaucoup n’y ont vu que la conclusion de la trilogie Cornetto, parangon de coolness par excellence, d’autres ont vu, sans doute du fait des aliens contenus dans le film, l’esquisse d’un constat : l’Angleterre n’était peut-être plus assez grande pour contenir le talent d’Edgar Wright. L’Amérique s’imposait donc d’elle-même pour le trublion britannique, qui n’aura d’ailleurs pas tardé en s’acoquinant avec l’un des plus célèbres studios US – Marvel- pour qui il a caressé l’espoir de mettre en scène Ant-Man. La suite, on ne la connait que trop bien : débarqué à l’amiable pour cause de divergences créatrices, Wright s’en est allé, souhaitant éviter de voir son style totalement oblitéré dans une grosse mécanique dont il n’aurait été que l’instrument. Cette défection aura cela dit été salutaire puisque non content d’avoir raté sa première incursion dans le milieu, le britannique aura préparé le terrain pour la suite, quitte à faire sortir de terre, un vieux projet – Baby Driver- grimé en véritable lettre d’amour au heist-movie. Un genre ultra-codifié du ciné US jonché de gros classiques (Bonnie & Clyde, Heat, …) dont il nous tardait de voir si Wright n’allait que l’effleurer en jouant le clinquant copiste ou au contraire le dynamiter de l’intérieur comme il sait si bien le faire ?

Fun & Furious
Et ce qui est bien avec lui, c’est qu’on aura guère à attendre que 10min pour avoir un début de réponse. Puisque, à la manière de cette mémorable scène de Shaun of The Dead ou la clique de Simon Pegg tabassait sur fond de Queen un tenancier de bar grimé en zombie, le film se plait dès le début à laisser la musique prendre littéralement en otage toute la mise en scène. De quoi transformer le tout en une parfaite synesthésie tout juste effacée par une force cinétique bouillonnante. Car on cause certes musique dans Baby Driver. Martha and The Vandellas, Queen, Simon and Garfunkel…Tous y passent dans l’Ipod chargé à bloc de ce pilote au teint juvénile et taiseux chargé de convoyer pour Kevin Spacey. Mais on cause surtout mouvement. Ce même mouvement qui irriguait à sa manière le récent La La Land et transformait cette banale quête de merveilleux en une comédie musicale étincelante ; on le retrouve ici, sauf que la Cité des Anges est remplacé par la bourgade d’Atlanta et que les Stars de la City se sont transformé en guns étincelants et caïds patibulaires. Résultat, au film de casse espéré, on se retrouve avec une quasi comédie musicale criminelle. Et pensez bien que si l’on se risque à employer ce terme, c’est surtout parce que cette petite pastille pop-acidulée a plus à voir avec Gene Kelly que John Frankenheimer. Il suffit d’ailleurs de voir le début tonitruant en diable ou ce subtil plan séquence voyant Ansel Elgort remaker « Chantons Sous la Pluie » pour comprendre que c’est bien l’idéal déployé par Stanley Donen et pas Michael Mann qui inspire le britannique. Une inspiration qui dépasse heureusement la simple référence cinéphile puisque le cinéaste, fidèle à son style sait composer autour de ce maelström ambiant et en puiser justement ce qui fait la force de son cinéma : la légèreté.

Edgar is always (W)right
La légèreté oui. On mentionnait La La Land et Drive tout à l’heure et pour cause : si Baby Driver emprunte le moove du premier, c’est bien pour compenser l’âpreté du second. Puisqu’il faut bien le dire : cette histoire de chauffeur taiseux qui roule pour la Mafia et a pour seul compagnon sa ribambelle d’Ipod chargés à bloc, ça sent le vécu. Ca sent Drive. Et inutile de rappeler que dans Drive, sitôt que vous êtes dans un ascenseur ou l’arrière d’une voiture, vous êtes soit mort soit voué à l’être. Et ça, Wright l’a bien compris. Pas question donc d’aligner les cadavres en mode « Règlement de compte à O.K Corral » mais bien désamorcer la pression en insufflant ce petit brin de légèreté bien à lui. Dans Shaun of The Dead, c’était Simon Pegg prêt à braver tous les dangers pour sa belle. Dans Hot Fuzz, l’inénarrable duo Frost/Pegg. Dans Baby Driver, c’est sans surprises Baby. Son teint juvénile, son mutisme, sa pureté, tout concoure pour le transformer en pur personnage wrightien. Mais on se doutait que le film ne se résumait pas qu’à un personnage taiseux quand même ; que Wright allait dérouler d’autres joyeusetés susceptible de rappeler aux derniers du fond qui dorment, qu’on est bien dans son monde. Et ce qui est bien, c’est que trop content qu’il est à faire son film US, Wright se fait pas prier pour le montrer. Une B.O aussi endiablée qu’éclectique, une mise en scène millimétrée, un ton rigolard, plein de 2nd degré et surtout un bestiaire de trognes bien taré (entre un Jamie Foxx grimé en braqueur gangsta-rap et la paire Jon Hamm/Elena Gonzalez dont l’apparence Bonnie & Clyde 2.0 est tout sauf fortuite) : pas de doute, on gravite autour de la galaxie Wright. Et dieu sait que par les temps qui court, se taper un film aussi cool et dont l’identité de son metteur en scène transpire de chaque image, c’est quasi criminel.

Shoot d’adrénaline stylisé à l’excès autant que leçon de mise en scène, Baby Driver est un sommet de coolness jubilatoire & totalement fou. Référentiel, nerveux et fun, nul doute qu’Edgar Wright a parfaitement réussi son exportation au pays des yankee en livrant un film qui fait aimer le cinéma.