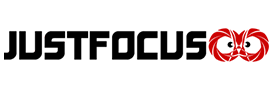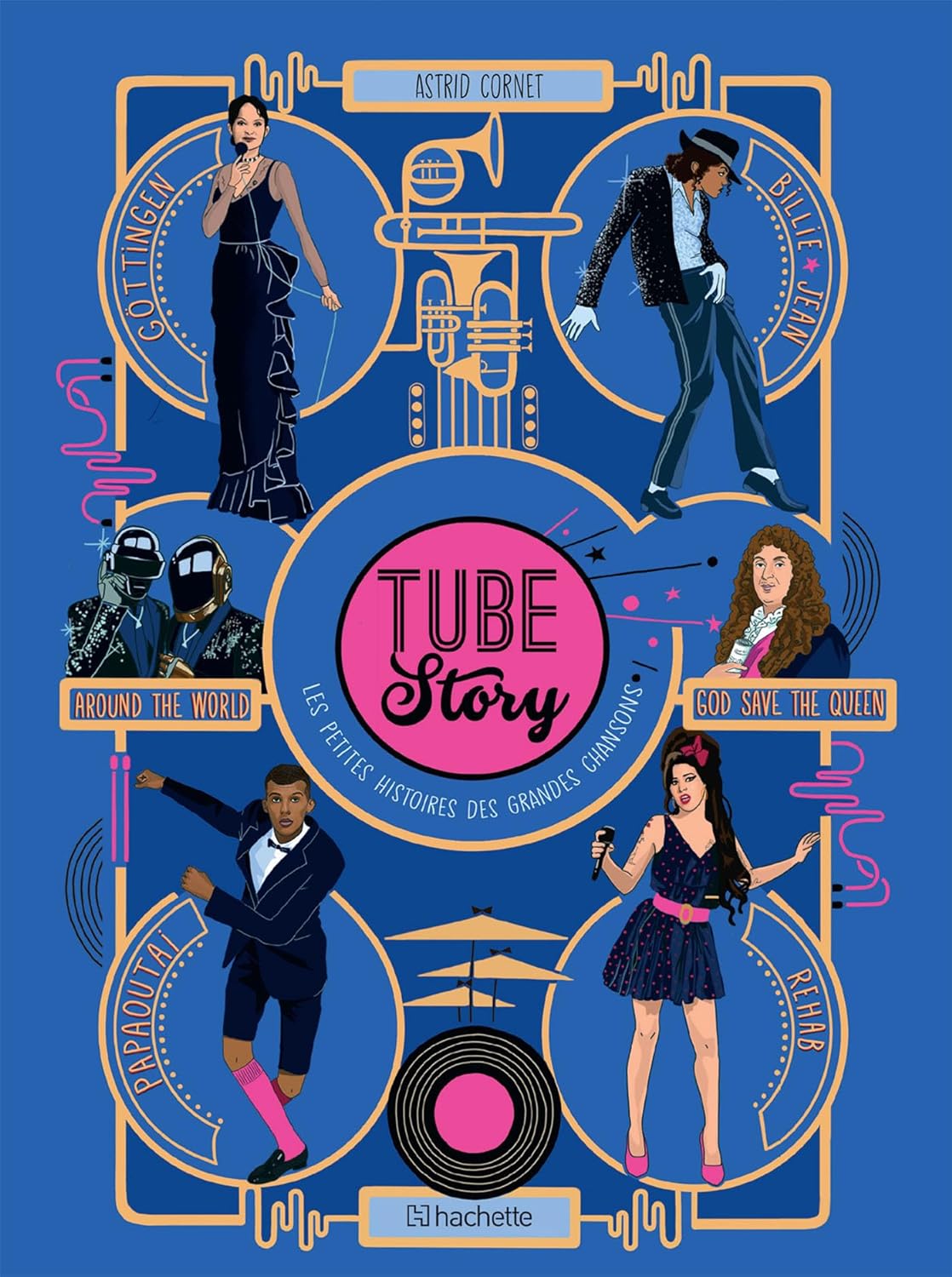Après un film politique avec Pentagon Papers (2017), après un film de science-fiction avec Ready Player One (2018) et après le premier remake de sa carrière avec West Side Story (2021), le grand Steven Spielberg change encore de registre avec The Fabelmans. Cette fois, le cinéaste se lance dans une autofiction passionnante où il raconte de manière déguisée son enfance, sa relation avec sa famille et son désir grandissant de réaliser des films.
The Fabelmans : l’auto-fiction, un genre très à la mode
Décidément, le genre de l’autofiction est très en vogue ces dernières années, et de grands cinéastes se penchent sur la question. Après Kenneth Branagh avec Belfast, Paul Thomas Anderson avec Licorize Pizza ou encore James Gray avec Armageddon Time, c’est au tour de Steven Spielberg de raconter de manière détournée sa propre enfance. Le cinéaste troque le nom de Spielberg pour celui de Fabelmans, qui se traduit littéralement par les hommes-fables. Une manière pour lui de mettre en scène son enfance et son adolescence dans les années 1960. Côté casting, le cinéaste choisit Paul Dano pour incarner son père, Michelle Williams pour camper sa mère et l’incroyable Gabriel LaBelle pour jouer son propre rôle.

Comme toujours dans le cinéma de Steven Spielberg, The Fabelmans mélange avec brio l’intime et le divertissement populaire. Comme souvent dans sa filmographie, le maestro parvient à proposer une mise en scène à la virtuosité folle et surtout discrète. Speilberg est un cinéaste qui sait doser, qui a un souci de l’équilibre unique et parfaitement coordonné. Sans esbroufe, sans excentricité, il propose un récit de l’intime marié à un divertissement vif et stimulant comme il en a le secret. Et comme d’habitude, Steven Spielberg s’impose comme l’un des meilleurs (si ce n’est le meilleur) conteurs du cinéma américain.
Des personnages efficaces
Et ce doux mélange entre intime et grand public se ressent surtout dans l’écriture de ses personnages. Avec The Fabelmans, Steven Spielberg veut évidemment rendre hommage à ses parents. Il veut évidemment rendre hommage à sa famille, à l’éducation qu’elle lui a inculquée, à ses sœurs, à ses grands parents. Nostalgique d’une époque révolue, Spielberg signe ici un film presque testamentaire, et surtout d’une honnêteté sans pareil. Il réalise le film d’une vie, son héritage pour sa famille mais aussi pour son public. Spielberg se met à nu et raconte le destin finalement assez classique d’un adolescent mal dans sa peau qui a trouvé la réponse dans le septième art. Mais c’est aussi ce classicisme qui en fait un film criant de vérité, et surtout très évocateur pour son public.
Parce que Spielberg n’a pas eu une enfance difficile. Il a grandit entouré d’amour, entouré de culture, de musique et de cinéma. Le jeune Sammy Fabelman rencontre finalement les mêmes difficultés que tous les autres adolescents aisés de cette belle planète bleue. Il passe par les mêmes tribulations universelles que sont les décès des grands-parents, les premières peines de cœur, le divorce des parents, le harcèlement des petites frappes à l’école, la recherche de soit, bref, rien de bien renversant. Et c’est cette simplicité dans son enfance qui permet de concerner le spectateur, qui se retrouve ainsi dans un récit significatif, qui le renvoie à sa propre enfance.

Mais plus qu’un film sur lui, The Fabelmans est surtout une œuvre sur sa mère. Brillamment incarnée par Michelle Williams, c’est elle son héroïne et l’héroïne de son épopée familiale. Avec The Fabelmans, Steven Spielberg dévoile son histoire et celle de sa mère. Par ce biais, il retrace évidemment sa construction identitaire, mais aussi, en parallèle, la déconstruction, puis la reconstruction, de la figure maternelle. Il raconte avec émotion le rôle qu’elle a joué dans le façonnement d’un petit prodige du septième art. C’est elle qui lui donne des solutions pour gérer ses angoisses et ses pulsions, c’est elle qui lui ouvre les yeux sur la complexité de la vie, mais aussi de l’art et de l’amour. Steven Spielberg met en scène une forme de symbiose entre Sammy et Mitzi Fabelmans, qui est intégrante de son développement personnel.
The Fabelmans met également en scène la relation triangulaire complexe entre le père, la mère et le fils aîné. Une position difficile pour lui dont il parvient à s’accommoder avec le temps, voir même à accepter et à exploiter les faiblesses dans ses premières productions cinématographiques. Des films qui sont un véritable remède pour le jeune Spielberg, qui combat ses peurs et ses névroses une caméra à la main.
Un hommage au septième art
Évidemment, puisque The Fabelmans parle de cinéma, Steven Spielberg n’oublie pas de rendre hommage au septième art. Via une photographie sublime, une direction d’acteurs exceptionnelle (Seth Rogen, Paul Dano, Michelle Williams et Gabriel LaBelle sont impressionnants), et un jeu sur les lumières et les ombres magnifique, Steven Spielberg offre sa propre déclaration d’amour à sa passion, à sa vie : le cinéma.

Spielberg use de l’intégralité du champ lexical du septième art avec The Fabelmans pour signer une déclaration d’amour touchante, raffinée et délicate. Il dresse une poignée d’images sensibles et poétiques telle que celle d’un enfant émerveillé/inquiété par le déraillement d’un train, son premier souvenir de cinéma. Le clin d’œil à L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat des frères Lumière est évident, et le rapport à l’enfance, qu’il soit par le prisme de l’innocence ou de la création, est d’une puissance simple et inouïe. Puis viennent les projecteurs, les salles de cinéma, les pellicules, les instruments de montage, tant de décors, de détails, qui permettent à l’assistance de vivre le cinéma à pleines mains. Enfin, on s’en voudrait de ne pas citer David Lynch, épatant dans la peau d’un John Ford expéditif et ronchon, encore un exemple de son hommage pour le septième art. Avec The Fabelmans, Steven Spielberg retourne aux sources de son propre art et rend grâce à l’artisanat du cinéma.
Sans révolutionner le genre ou les thématiques qu’il aborde, Steven Spielberg signe un film solide avec The Fabelmans. Le cinéaste parvient à capter l’émotion qu’il recherche et parvient, une fois de plus, à rendre l’intime extrêmement cinématographique.