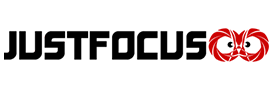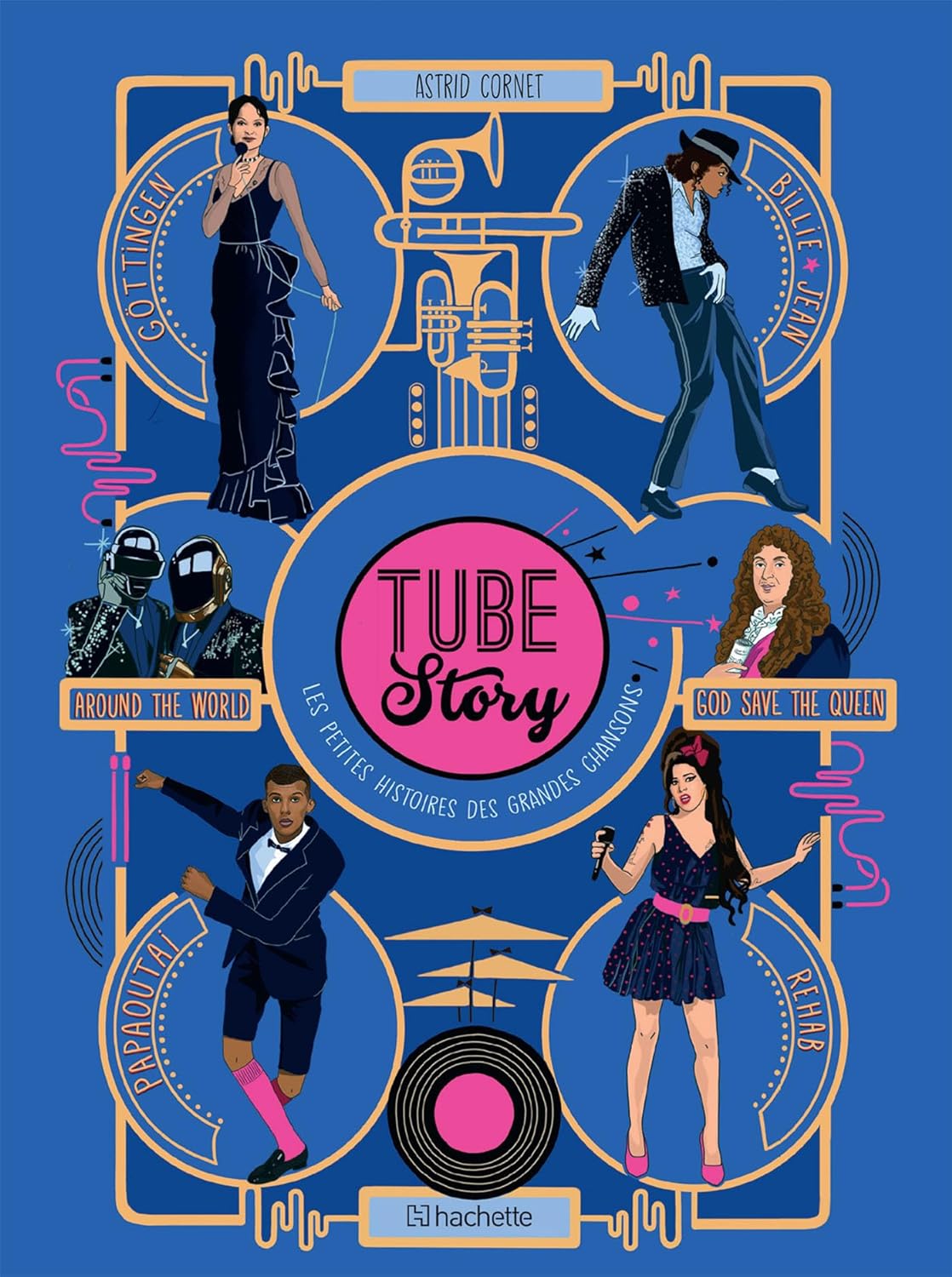Difficile pour Disney de larguer en mer une de ses franchises les plus coûteuses mais aussi lucratives. Six ans après le très décevant La Fontaine de jouvence, la franchise tente de renouer avec les éléments qui faisaient le sel des premiers opus, à la croisée du spectaculaire, d’une fantaisie folklorique parfois inquiétante et d’un humour cabotin. Hélas, malgré quelques bonnes intentions, Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar souffre d’une trop grande conscience de lui-même pour parvenir à nous séduire avec la même naïveté que les premiers films.
Retour aux sources d’une piraterie cabotine

Jack Sparrow se retrouve une nouvelle fois en fâcheuse posture. Un ennemi du passé, le Capitaine de Salazar, s’apprête enfin à concrétiser son rêve de vengeance envers celui qui a causé sa perte. Aidé d’Henri Turner et de Carina Smyth, il doit à tout prix tenter de sauver (encore une fois) sa peau. Exit, Rob Marshall qui avait assuré une transition à minima respectueuse après Gore Verbinski et place au duo norvégien Roenberg à l’origine du peu subtil Bandidas. Cela tombe bien, la finesse n’est pas vraiment l’apanage de la franchise. Loin de s’angoisser des contraintes de cohérence et la consistance du récit, la formule réside finalement dans le savoureux télescopage des tons qui allie le burlesque à des tonalités plus épiques tout en prenant quelques détours vers des horizons plus dramatiques. Ce cinquième opus ne déroge pas à la règle de cette mécanique bien huilée qui n’a rien à envier à la machine marvelienne. Le spectateur retrouve Sparrow et son équipe de bras cassés, le Capitaine Barbosa, la soif colonialiste de l’Empire britannique, les prisons, les îles, ses mystères et ses dangers, son antagoniste revanchard et son caméo (que l’on retrouve dans une scène d’échanges fort délectable entre Paul McCartney et un Johnny Depp (encore) en fâcheuse posture.) Le point de départ s’avère ainsi plutôt dramatique et part finalement d’un postulat fort intéressant : celui de l’absence du père. Le fil rouge narratif se retrouve dans cette quête des fils et des filles qui tentent de sauver le paternel ou bien de perpétuer un héritage. Un héritage qui provoque finalement une mise en abyme du film lui même qui tente de renouer avec ses origines après un troisième opus au rythme calamiteux et à un quatrième opus vide, épuisé de toute substance et d’intérêt narratif, reposant sur la mise en exergue des pirouettes cabotines du personnage de Jack Sparrow. Ici, exit le duo des jeunes éphèbes à la romance insipide pour laisser place à un duo de personnages (incarnés par les sympathiques Brenton Thwaites et Kaya Scodelario) au tempérament infiniment plus captivant et étoffé que leurs caricaturaux prédécesseurs. C’est donc le retour d’une dynamique triangulaire qui évite à Johnny Depp de phagocyter l’écran. On note aussi un retour de protagonistes originels dont l’ombre planera et finalement motive de manière sous-jacente un récit démultiplié comme à l’habitude. Le spectateur se retrouve ainsi face à un divertissement choral en grande pompe qui remplit le cahier des charges minimal et satisfera les envies primaires du spectateur seulement prédisposé à se divertir sans trop s’embêter de considérations intellectuelles.
Au bout de l’horizon caribéenne

Hélas, finalement la plus grande réussite du film réside dans le retour (inconsciemment) lucide qu’il fait sur lui même. C’est ainsi qu’un des personnages du film s’exclame en ces mots « Nous avons atteint le bout de l’horizon ». Et c’est finalement bien l’impression qui émane tout du long du film. Cette impression d’avoir cartographié toutes les zones potentielles de la franchise. Car le film reprend sans la renouveler une formule épuisée qui s’est transformée en un poncif agaçant. Pourtant plus et mieux calibré que ses prédécesseurs, le film souffre grandement d’une perte exponentielle de l’ingéniosité, de l’emphase, des références, d’un art du divertissement finalement qui parachèvent un goût d’inutilité. Plus encore, c’est la perte de l’effet de surprise qui annihile totalement le film. Malgré quelques scènes inventives à la mécanique efficace dans lesquelles humour et danger se confrontent dans une situation immédiate (délicieux moment que la scène de la guillotine), le spectateur se trouve face à un monde totalement démystifié dans lequel il est possible de rejoindre le Hollandais Volant comme on va chercher son pain. Finalement, les cabotinages constants de Johnny Depp (qui ne semble plus y croire) finissent par agacer et atomisent l’implication d’un spectateur épris de passivité. Le personnage tout comme la franchise semblent être arrivés au bout de leur propre légende. C’est là où le flashback présentant un Jack Sparrow jeune, fringuant à la conquête de sa destinée prend une autre dimension. Que dire par ailleurs face à un capitaine Barbossa qui n’est plus qu’un roublard grisé par sa fortune et reproduisant sous forme de microcosme d’une société britannique ? Reste un Javier Bardem incarnant un capitaine Salazar aussi cruel que charismatique et qui parvient à retenir notre intention parmi ces flots bien vides …
Ainsi, Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar n’est pas le naufrage qu’a pu être son prédécesseur. Toutefois, il se trouve amputé d’une fraîcheur et d’une naïveté fantaisiste à tout jamais perdues. Il serait donc peut-être temps de jeter l’ancre définitivement …
Sortie le 24 Mai.
https://www.youtube.com/watch?v=QPel3QTdhTI